Que ce soit dans le cadre d’une thèse, d’examens de partiels, d’un mémoire, d’un oral ou même d’un article de blog 😋, maîtriser l’art de l’introduction et éviter les blocages est une question délicate. C’est un moment clé qui révèle beaucoup sur notre manière de travailler et d’appréhender un sujet. Par où commencer sans être maladroit, et surtout, comment éviter les blocages ? Si vous vous demandez comment écrire avec assurance et introduire élégamment le sujet que vous étudiez, vous êtes au bon endroit. Je vous propose de dissiper les angoisses liées à ce moment d’écriture en vous offrant quelques conseils simples à suivre.
Introduction
« Faire entrer quelque chose quelque part », « action d’introduire quelqu’un dans un groupe », ce sont les définitions que l’on retrouve dans notre fidèle « Larousse ». Le terme est également synonyme d’admission, d’entrée ou d’intrusion. Et finalement, cela correspond plutôt bien à l’objectif de votre introduction. Il s’agit de présenter votre sujet à la communauté scientifique, de faire admettre vos recherches dans le domaine, et de vous frayer une place dans le milieu. Et cela fonctionne même à une échelle plus réduite, que ce soit pour un rapport de stage, un exposé ou une dissertation, etc.
À quoi sert l’introduction ?
Alors voilà, l’écriture de l’introduction est un point nodal dans votre rédaction qui peut se construire en deux étapes : l’explication des savoirs de base et la remise en contexte de ces connaissances. L’introduction permet ainsi de reconstruire l’historiographie de votre sujet, de positionner votre méthode et d’annoncer votre ligne de conduite.
L’introduction va permettre de tracer les contours de votre bibliographie, de votre corpus et la manière dont vous faites discuter tout cela. Divisée en deux ou trois parties, elle cerne les contours géographiques, thématiques, chronologiques et historiographiques afin d’éviter toutes ambiguïtés.
Enfin, l’introduction sert à problématiser votre sujet. Son rôle est de poser tout ce qui dérange. C’est le moment de remettre en question, de critiquer et d’énoncer vos solutions dans votre annonce de plan. L’ensemble doit être souple, clair et l’enchaînement des parties sans accroc.
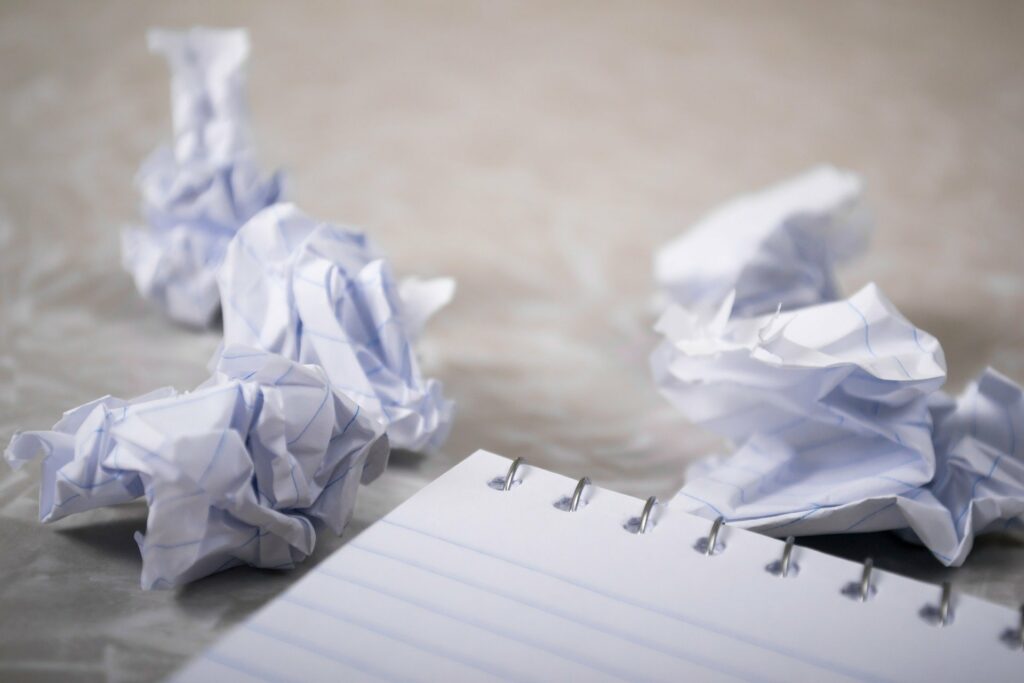
Comment amorcer l’écriture ?
Avant de rédiger, élaborez un brouillon soigné et commencez par définir les termes clés de votre sujet en rappelant les grandes notions qu’ils impliquent. Identifiez les auteurs essentiels de votre historiographie, en mentionnant les principales dates de la recherche. Décrivez clairement votre corpus ainsi que le matériel étudié, en le replaçant dans son contexte. Notez les questions cruciales que vous vous êtes posées au cours de vos travaux. Enfin, annoncez votre problématique et détaillez la manière dont vous allez la résoudre dans le cadre de votre développement.
La phrase d’accroche est-elle obligatoire ?
Pour bien lancer la rédaction, il est surtout important de contextualiser le sujet d’entrée de jeu. Ne faites pas de détours inutiles, dites les choses directement.
Par exemple, dans le cadre de ma thèse, lors de la rédaction de mon introduction, j’ai simplement entamé avec une citation qui capturait bien l’essence de mon sujet, accompagnée de cette première phrase : » On retrouve, dans les « Promenades archéologiques », publiées en 1896 par Gaston Boissier, un certain nombre d’idées qui concernent l’existence de répétitions de thèmes mythologiques dans les domus pompéiennes et leur mention dans les récits de voyage des XVIIIe et XIXe siècles. »
L’objectif de la première phrase de votre introduction est d’inciter le lecteur à se demander : ‘Ah oui, vraiment, pourquoi ?‘ Une citation tirée de vos lectures s’avère toujours pratique pour amorcer ce processus.
Mes 5 conseils pour éviter les blocages !
Très bien, voici une série de conseils pour progresser efficacement ou débloquer votre rédaction.
#1 Collecter les faits, établir des liens et questionner
En délimitant les contours géographiques, thématiques, chronologiques, et historiographiques (j’insiste volontairement), vous prenez du recul par rapport à votre sujet et faites émerger quelque chose de nouveau. L’introduction est l’endroit où vous établissez votre liste d’hypothèses dans l’ordre d’importance qui vous est propre. Ainsi, vous explicitez les réseaux de connaissances auxquels votre étude se rattache.
Dès l’introduction, vous devez donc rappeler trois éléments essentiels : Que cherchons-nous ? Que voulons-nous démontrer ? Et qu’est-ce que je ne sais pas ?
#2 Dresser un état des lieux des archives et des sources
L’abondance de documents à étudier ou leur raréfaction intervient forcément dans la réflexion. Il est donc important de bien définir son corpus pour identifier les lacunes qui ont été les vôtres. Vous pouvez ainsi énoncer vos faiblesses et les résoudre ensuite dans la conclusion. Toutes les questions doivent être posées, même si cela prend la forme d’un rapport banal de faits.
L’introduction doit délimiter le périmètre de votre sujet et de vos ambitions. La mise en question explicite l’ensemble et lui donne du relief. C’est également le moment pour vous d’indiquer ce qui n’a pas fonctionné dans vos hypothèses. Parfois, cet état des lieux stimule la réflexion et vous inspire de nouvelles directions à prendre.
#3 Se positionner dans l’histoire des savoirs
L’introduction doit expliciter l’historiographie de votre sujet et ses niveaux de discours : idéologiques, culturels et sociologiques. Vous devez prendre position, c’est inévitable. De plus, on vous demandera forcément de justifier vos choix entre tels ou tels auteurs, autant anticiper…
Car oui, l’introduction vous permet d’anticiper les critiques de la soutenance en rappelant les allers-retours qui ont été faits entre auteurs et savoirs : qui dit quoi et quand ? Pourquoi ? À quelles fins implicites ou explicites ? D’où vient-il et selon quel mérite ? Et qu’en est-il de vous ? Et le plus important : comment votre démonstration et votre problématique s’insèrent-elles dans cet héritage ?
#4 Déconstruire pour problématiser
Démontez l’ensemble de votre corpus documentaire en mettant en lumière les cohérences et incohérences dans l’étude de votre sujet. L’introduction permet de tisser votre sujet dans un réseau d’idées en lien avec votre problématique. Elle offre l’opportunité de dresser le bilan des discours qui sont survenus ou absents, et qui seront justifiés plus tard dans votre démonstration. L’un des objectifs de l’introduction est de déterminer votre place dans l’état des savoirs.
#5 Proposer votre grille d’analyse personnelle
L’annonce de votre grille d’analyse se fait dans l’introduction, suivie de près par votre problématique. Votre grille d’analyse peut également faire office d’annonce de plan. Profitez-en pour anticiper les imprévus qui seront résolus dans la conclusion, ainsi que pour exprimer vos ambitions.

Quand rédiger son introduction ?
Y a-t-il un meilleur moment ? Je ne le pense pas. Je conseillerais simplement de ne pas rédiger l’introduction dans l’urgence en fin de projet. Comme la conclusion, il s’agit d’un bloc important de votre rédaction qui conditionne le reste de la lecture et le point de vue de votre lecteur.
Vous pouvez donc insérer des éléments au fur et à mesure de votre réflexion dans un fichier brouillon. Ce fichier grandira avec votre réflexion et reflétera votre avancement. C’est par ailleurs très pratique pour justifier de vos progrès lors des entretiens.
Personnellement, j’ai rédigé mon introduction au cours de ma deuxième année de thèse, à un moment où j’avais besoin de poser les choses pour avancer. Ce travail a relancé mon intérêt en éclairant certains points incertains. Mon introduction a ensuite évolué avec mes recherches jusqu’à la fin. J’ai suivi une approche similaire pour la conclusion, en troisième année, en la considérant comme le miroir de mon introduction. Qu’en pensez-vous ?
✏️ N’hésitez pas à partager vos conseils en rédaction dans les commentaires. Je serai ravie de découvrir vos impressions pour maîtriser l’art de l’introduction et éviter les blocages !
✨ Envie de poursuivre la lecture ? Je vous invite à lire cet article pour approfondir ce sujet : Comment formuler une problématique pertinente ?
👉 Restez connectés à l’actualité de Place Plume sur Instagram et Facebook, et abonnez-vous à la newsletter du blog dans le menu à droite de votre écran. Vous recevrez toutes mes astuces et mes conseils en rédaction une fois par mois dans votre boîte mail.

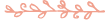
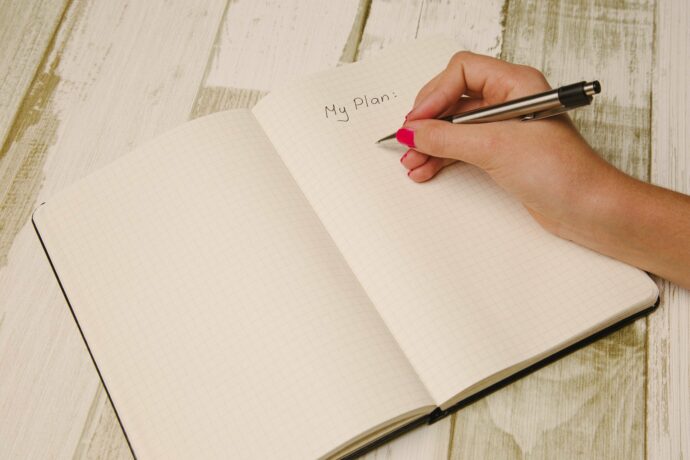
0 Comments