Écrire une thèse, un mémoire ou un livre est un exercice singulier. C’est une aventure qui demande méthode et persévérance pour parvenir à un résultat novateur dans les délais impartis. Elle nécessite également la capacité à effectuer des choix parfois délicats, à délimiter un cadre précis et à formuler des conclusions percutantes pour se démarquer. Dans cet article, je vous propose de suivre étape par étape le processus de décomposition d’un sujet, depuis le choix initial jusqu’à l’impression du manuscrit, afin de produire un contenu de qualité. Ces conseils peuvent être adaptés à divers types de travaux académiques.
Les bases de la recherche en Histoire de l’art
Rassembler et évaluer la documentation
Au cours de cette phase de recherche, votre tâche consiste à collecter et à compiler une documentation substantielle pour élaborer des hypothèses. Vous devrez examiner les travaux d’autres auteurs afin de résoudre des questions méthodologiques et conceptuelles. Il se peut même que vous exploriez d’autres domaines ou périodes, car de temps en temps le hasard joue en votre faveur.
La critique de votre bibliographie est cruciale dans la construction d’une trame d’hypothèses. L’essence de ce travail réside dans la capacité à interpréter l’absence d’information et à comprendre pourquoi certaines lacunes persistent dans les études. Votre objectif est de démontrer les raisons pour lesquelles certains experts ont évité le sujet. C’est dans cette aptitude que réside l’originalité de votre approche.
Délimiter et définir son corpus
Avant tout, il est essentiel de définir clairement votre corpus. Sur quoi portera votre travail ? Comment l’organiserez-vous ? Quelles méthodes utiliserez-vous pour analyser les œuvres ? Votre lecture des œuvres dépend largement de votre organisation, ou même de votre désorganisation.
Rien n’est neutre, tout est connecté. L’organisation que vous proposez doit refléter des règles déterminées par votre sujet et la manière dont vous avez l’intention de le traiter. En d’autres termes, votre approche du sujet influence le développement de la méthode la plus appropriée. Vous trouverez des détails plus spécifiques à ce sujet dans un autre article dédié à la méthode en histoire de l’art.
Comment rédiger sa thèse ?
L’objectif ultime est de créer un contenu original et de qualité, susceptible d’être publié. Cependant, maintenir une perspective objective et rester motivé au fil des mois peut s’avérer ardu. Certains préfèrent réfléchir au fur et à mesure, tandis que d’autres privilégient une approche anticipative, cherchant à avoir une vision claire de la progression de leur recherche. Trouver l’équilibre entre ces approches divergentes constitue souvent un défi majeur.
Le plan de votre thèse
Le plan est le rendu visible de votre méthode et de votre organisation. Il sert à définir les attentes de votre question de recherche. Le jury attend des éléments spécifiques à votre sujet et sera attentif aux incohérences ou aux choix effectués. Ainsi, le plan de votre thèse doit refléter une réflexion théorique et méthodologique solide. Il doit également présenter un angle de réflexion original sur votre sujet, accompagné d’une justification claire de votre problématique. Il est essentiel de le soumettre à une lecture précoce afin de tester sa clarté.
Le développement et ses parties
Pour amorcer le développement des parties, commencez par libérer des idées qui évolueront naturellement. L’écriture d’un texte ne démarre jamais à partir de rien. Rassemblez vos idées avant de vous lancer. Jetez des phrases, organisez les mots-clés dans des catégories… Établissez une hiérarchie d’idées au fil de vos recherches. Créez des listes en rédigeant de courts paragraphes ici et là. Une fois que vous êtes bien lancé, les lignes s’égrèneront d’elles-mêmes jusqu’à ce que la fatigue se fasse sentir.
L’écriture est un muscle. Restez serein et écrivez lorsque vous êtes frais, car c’est dans cet état que l’écriture prend toute sa force. Personnellement, j’ai rédigé ma deuxième partie de thèse après une naissance, et je peux vous assurer que les nuits blanches ne sont pas de très bonnes conseillères.
L’introduction et la conclusion : les deux piliers de votre manuscrit.
L’introduction et la conclusion représentent les deux piliers fondamentaux de votre manuscrit. Leur élaboration est progressive et exige une base documentaire solide. Agrémentées de paragraphes structurés, l’introduction et la conclusion sont rédigées en miroir. Tout au long de votre recherche, constituez un petit fourre-tout contenant une ébauche de plan ainsi que des éléments d’introduction et de réponse pour la conclusion. L’introduction marque le moment où tout se met en place. Elle doit démontrer l’ensemble de votre démarche. La conclusion aborde les questions demeurées sans réponse et clôture le manuscrit.
Le reste du mémoire se construit méthodiquement, que ce soit dans l’ordre linéaire ou par montage successif, tel le travail minutieux d’une couturière. Chaque partie doit être autonome tout en maintenant des liens cohérents avec les autres. Une section complète devrait comporter une brève introduction, un développement approfondi et une conclusion significative. À chaque étape, expliquez les orientations, les contestations, vos constatations et les résultats obtenus. L’objectif est de permettre au jury de percevoir un enchaînement logique tout au long de votre travail.
Le produit final de votre travail
La conception du produit final doit être pensée tout au long de l’écriture. Environ un an avant la soutenance, il est crucial d’avoir une vision claire du rendu définitif. La bibliographie doit suivre les normes attendues. Le nombre d’annexes doit être déterminé. Les photographies doivent être sélectionnées et présentées dès la conception, avec leurs légendes et leurs emplacements définitifs. La mise en page doit être réfléchie progressivement.
L’édition représente une étape qui requiert du temps et une attention minutieuse. La question de préférer un sommaire ou une table des matières se pose. L’équilibre des parties, la simplicité et la logique de la forme et de la structure doivent être examinés attentivement.
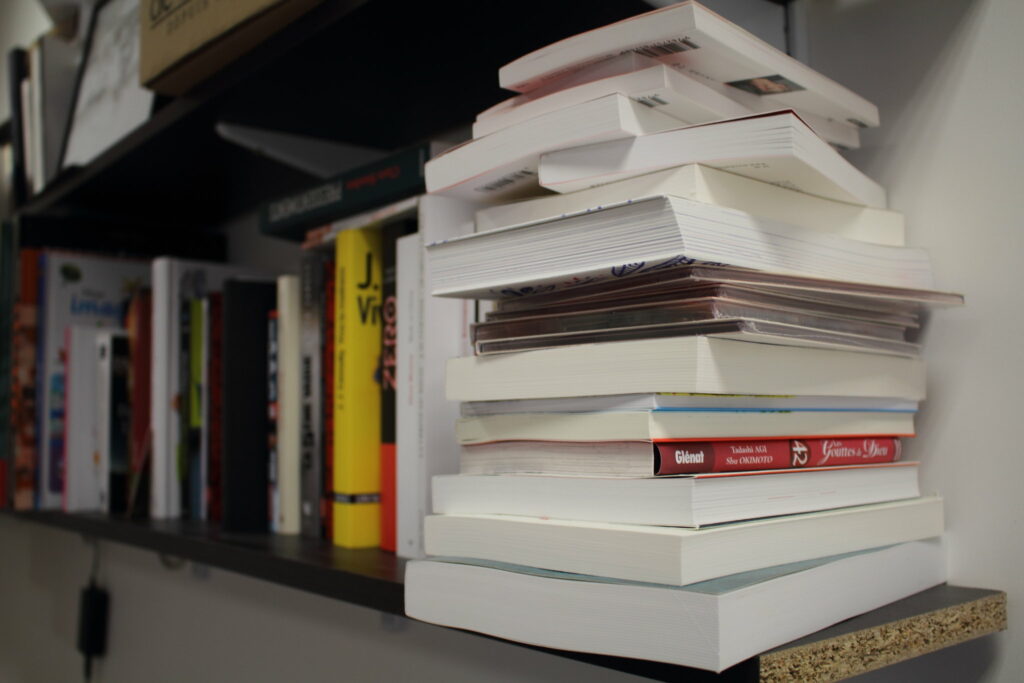
Anticiper les délais pour le dépôt administratif est une étape cruciale
La relecture ne peut être achevée du jour au lendemain, c’est physiquement et techniquement impossible. Il est essentiel de prévoir un mois de latence entre la fin de la relecture et le dépôt pour anticiper d’éventuels imprévus avec l’école doctorale ou le directeur de thèse. Même si l’impression du manuscrit se fait souvent au dernier moment, votre document doit être impeccable pour le dépôt.
L’adaptation et l’anticipation sont essentielles lorsque l’on approche de la fin, et il est crucial de ne pas céder à la panique. La forme du document reflète le contenu. Un manuscrit déséquilibré et peu esthétique peut révéler des problèmes conceptuels. Prenez le temps de relire vos notes, organiser vos références et aligner les paragraphes et les parties. Le jury est particulièrement attentif aux détails, surtout lorsque le contenu est déjà bien construit et ne nécessite que peu de critiques.
La soutenance en quelques mots
La soutenance devrait être, avant tout, un moment de plaisir. Il s’agit de faire ressortir les moments agréables vécus au cours de ces années de travail. Il est essentiel de transmettre de manière positive ce qui a été accompli. Cependant, cela ne signifie pas faire abstraction de la réflexion critique. Il est crucial d’aborder les questions non résolues et de discuter de votre approche pour résoudre les problèmes.
Ce moment offre l’opportunité d’expliquer les lacunes, les défauts, et les choix effectués. Rappelez pourquoi ce sujet a été choisi et comment la réflexion a été menée. Décrivez votre méthode ainsi que les problématiques qui ont orienté vos décisions. Enfin, il vous revient de mettre en évidence ce qui vous semble essentiel et de proposer une ouverture à la fin.
La soutenance représente un moment crucial où vous devez vous positionner dans votre domaine. Il peut parfois être décisif, ouvrant d’autres portes vers le monde professionnel et scientifique.
Conclusion
L’écriture d’une thèse est une aventure intellectuelle exigeante, nécessitant méthode, persévérance et réflexion constante. Chaque étape, de la recherche à la rédaction finale, est une occasion de croissance personnelle et professionnelle. Anticiper les défis, maintenir une approche positive tout en étant critique, et se préparer soigneusement pour la soutenance et une possible publication sont des aspects cruciaux de ce parcours.
✏️ N’hésitez pas à partager vos conseils de rédaction dans les commentaires. Je serai ravie de découvrir vos impressions pour enrichir cette exploration.
✨ Envie de poursuivre la lecture ? Je vous invite à lire cet article pour approfondir ce sujet : Écrire avec assurance : guide pour maîtriser l’art de l’introduction et éviter les blocages !
👉 Restez connectés à l’actualité de Place Plume sur Instagram et Facebook, et abonnez-vous à la newsletter du blog dans le menu à droite de votre écran. Vous recevrez toutes mes astuces et mes conseils en rédaction une fois par mois dans votre boîte mail.

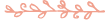




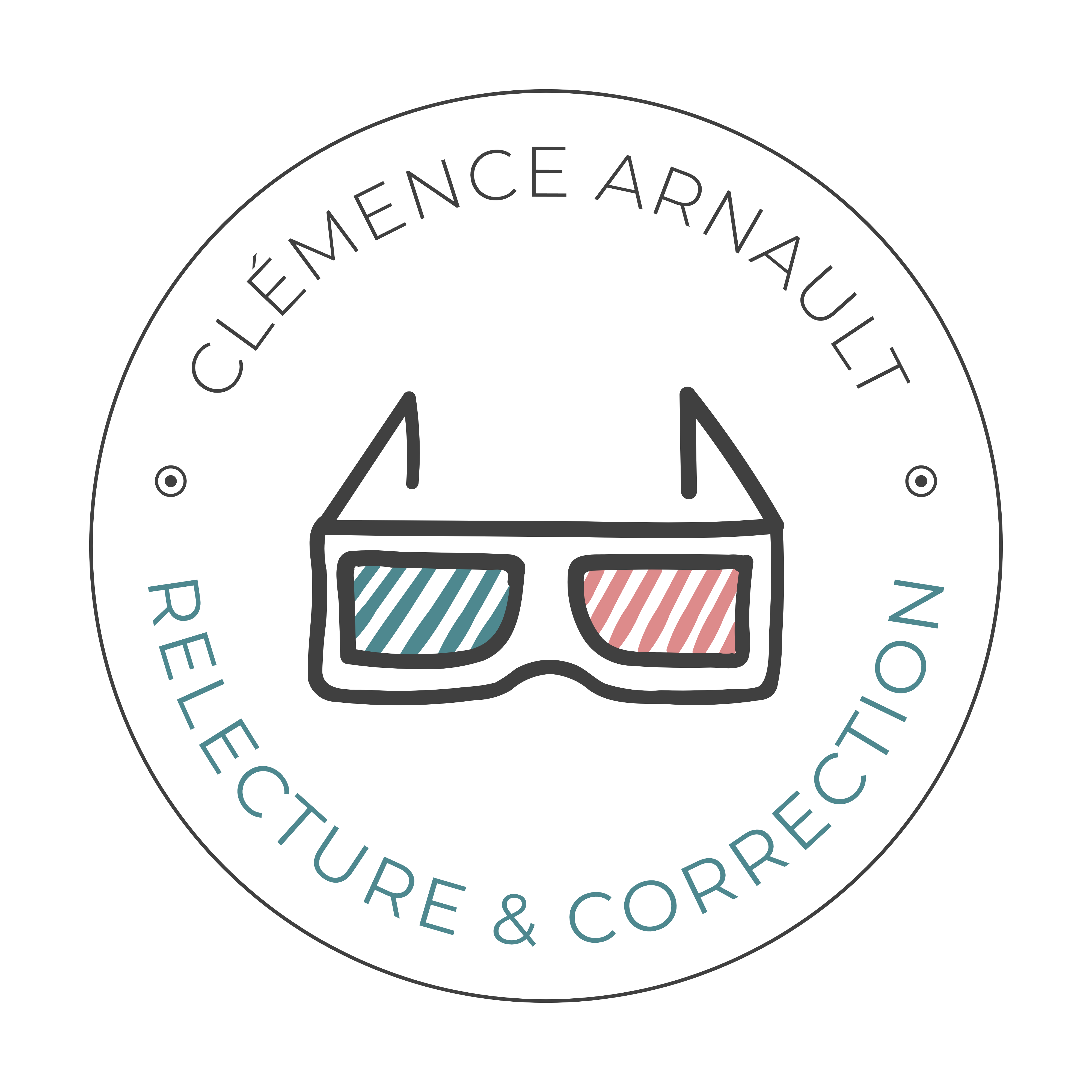
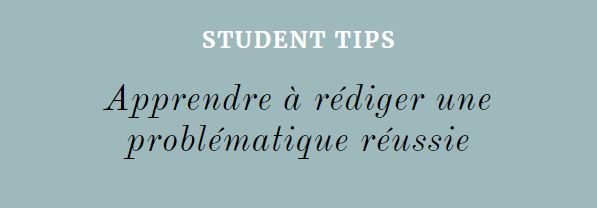
0 Comments