Bleu – Résumé
L’histoire de la couleur bleue dans les sociétés européennes est celle d’un complet renversement : pour les Grecs et les Romains, cette couleur compte peu et est même désagréable à l’œil ; c’est une couleur barbare. Or aujourd’hui, partout en Europe, le bleu est de très loin la couleur préférée (devant le vert et le rouge). Michel Pastoureau raconte l’histoire de ce renversement, mettant l’accent sur les pratiques sociale de la couleur (lexiques, étoffes et vêtements, vie quotidienne, symboles) et sur sa place dans la création littéraire et artistique. Il montre d’abord le désintérêt pour le bleu dans les sociétés antiques, puis suit la montée et la valorisation progressives des tons bleus tout au long du Moyen Âge et de l’époque moderne. Enfin, il met en valeur le triomphe du bleu à l’époque contemporaine, dresse l’histoire d’une couleur, un bilan de ses emplois et de ses significations.
Édition Point
240 pages
Critique d’art, encyclopédie, histoire et humanités
À propos de l’auteur : Michel Pastoureau est un historien médiéviste français, spécialiste de la symbolique des couleurs, des emblèmes, et de l’héraldique. Il est historien, archiviste, paléographe et directeur d’études à l’École pratique des hautes études (4e section), installée à la Sorbonne, où il occupe depuis 1983 la chaire d’histoire de la symbolique occidentale. Il a publié une quarantaine d’ouvrages consacrés à l’histoire des couleurs, des animaux et des symboles. Ses premiers travaux portaient sur l’histoire des emblèmes et les domaines qui s’y rattachent.
*Les liens avec une petite étoile sont affiliés – ça ne change rien pour vous – cela signifie que je suis susceptible de recevoir une commission si vous achetez via ce lien. Toutes les lectures recommandées sont des ressources que j’ai personnellement lues ou utilisées !
👉 En savoir plus : Compléter sa bibliothèque : 5 livres choisis par 5 Historiennes de l’art
Mon analyse littéraire
L’ouvrage de Michel Pastoureau suscite une réflexion pluridisciplinaire, faisant appel à plusieurs domaines tels que l’anthropologie, la linguistique et l’histoire de l’art. Après la publication de son « Dictionnaire des couleurs de notre temps » en 1992, l’auteur nous offre une perspective complète sur l’évolution des valeurs et de la sensibilité chromatique associées à la couleur bleue, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
La couleur est-elle un fait culturel et linguistique ?
Michel Pastoureau souligne l’importance de diverses techniques, telles que la peinture, les vitraux, les émaux, les étoffes, les blasons, les pierres précieuses et l’orfèvrerie, dans l’expression et la définition des couleurs. Cette nécessité est particulièrement prégnante pour la couleur bleue, étroitement liée à une multitude de contraintes matérielles, techniques, picturales, pigmentaires, chimiques, géologiques, esthétiques et économiques. Selon l’auteur, l’histoire de la perception du bleu requiert avant tout une exploration approfondie de l’industrie teinturière. Pastoureau entreprend ainsi une analyse approfondie de l’importation de la guède et de l’indigo, de leur commercialisation, ainsi que des procédés techniques visant à extraire cette précieuse teinte de bleu. Il suggère que l’industrialisation de la couleur a non seulement favorisé une évolution sociale, mais a également modifié la perception de cette couleur.
En retraçant l’histoire de la teinturerie, Michel Pastoureau met en lumière les conflits socio-économiques jusqu’au XVIe siècle, qui exercent une influence directe sur la signification et la perception symbolique du bleu. C’est peut-être précisément en raison de ces conflits que l’auteur souligne l’importance du statut de l’artisan, des pratiques de savoir-faire et des traditions artisanales, jouant un rôle crucial dans la perception d’une couleur.
Le langage relève d’une culture, de ce que l’on est capable de voir.
En mettant en relief les dynamiques économiques et sociales, Michel Pastoureau mobilise un éventail de disciplines, notamment la linguistique et la lexicologie, pour illustrer l’importance de l’évolution du langage dans la perception de la couleur bleue. Progressivement, le lecteur prend conscience d’un écart significatif entre les époques, les sociétés et les individus en ce qui concerne la dénomination de la couleur réelle, de la couleur perçue et de la couleur nommée.
Michel Pastoureau souligne également l’importance de mener une enquête heuristique et philologique pour définir la symbolique des couleurs. Selon lui, la perception d’une couleur est étroitement liée à la formation et au fonctionnement d’un lexique spécifique. Cette perception serait même influencée par les préférences individuelles, lesquelles sont à leur tour façonnées par un goût collectif et un phénomène de mode qui se reflètent dans le langage.
Le rôle social, liturgique et politique de la couleur bleue
Les habitudes du temps, ou les pratiques prévalant dans une période et une société spécifiques, sont inextricablement liées à la perception de la couleur bleue, tout comme les traditions locales et ancestrales. En effet, selon Pastoureau, « c’est la société qui fait la couleur, non pas l’artiste ou le savant, et encore moins l’appareil biologique de l’être humain ou le spectacle de la nature ».
En outre, la sensibilité ou la tendance collective permet également une réorganisation de la hiérarchie des couleurs, influençant ainsi les codes sociaux et les systèmes de pensée. Michel Pastoureau souligne l’importance des effets de mode, qu’ils se manifestent à travers les gravures, la publicité ou les vêtements. La couleur, dans ce contexte, joue un rôle essentiel dans le classement, l’association, l’opposition et la hiérarchisation, agissant comme un moyen classificatoire. Cet ouvrage démontre ainsi que les groupes sociaux se distinguent toujours par la couleur, motivés par des considérations économiques, éthiques ou idéologiques.
La couleur devient une marque distinctive intrinsèquement liée aux habitudes quotidiennes. Au Moyen Âge, par exemple, la perception de la couleur bleue était étroitement conditionnée par les codes chromatiques dictés par la liturgie, les réformes, les décrets politiques, ou encore par les avancées théologiques et artistiques de l’époque. Dans cette lignée, Michel Pastoureau explique comment le bleu se transforme en un signe de reconnaissance ou de provocation au-delà du domaine vestimentaire, à travers l’adoption d’emblèmes royaux ou nationaux. Il met en lumière la manière dont un groupe entier peut forger une culture commune en adoptant une couleur héraldique et symbolique. Ainsi, alors que le drapeau rouge symbolise la misère, le peuple opprimé et prêt à se révolter contre les tyrannies, le drapeau blanc occupe une place significative dans la représentation de la royauté. Selon Michel Pastoureau, la couleur se révèle être également une force symbolique.
Une histoire anthropologique de la perception ?
Cette synthèse historique explore divers aspects du domaine de l’histoire culturelle à travers la lentille de la perception des couleurs. Malgré le choix de l’auteur d’adopter une approche diachronique pour son étude, son analyse englobe largement les systèmes socio-symboliques que la couleur incarne.
Dans ce bref ouvrage, l’histoire des perceptions de la couleur est abordée de manière transdisciplinaire. En effet, il s’agit d’un sujet d’analyse qui a suscité l’attention d’un grand nombre d’historiens depuis l’Antiquité. L’analyse de Michel Pastoureau se présente ainsi comme une excellente synthèse des usages et des symboliques du bleu, une couleur façonnée, maîtrisée et diffusée de manière variée au fil des siècles.
Les points forts qui ressortent de cet ouvrage.
L’auteur propose une approche diversifiée de la perception de la couleur. Celle-ci est d’ailleurs davantage considérée comme une construction culturelle que comme un phénomène purement naturel. Par conséquent, elle nécessite une approche croisée de l’histoire de l’art, de l’histoire sociale, de l’histoire des sensibilités et de l’histoire des techniques.
En fin de compte, les quelque deux cents pages de ce livre offrent une compréhension approfondie des pratiques et des théories qui font de la couleur un élément constitutif de la culture d’une société à une période donnée. La couleur est indissociable de la société dans laquelle elle est perçue.
En résumé, cette analyse historique de la perception évolue vers une science de la culture. Elle explore les pratiques sociales, liturgiques et religieuses liées à la couleur, tout en examinant les spécificités langagières et les enjeux du vocabulaire. De plus, elle scrute les pratiques habituelles, politiques, religieuses et sociales qui définissent les codes et les usages culturels au sein d’une communauté. Ainsi, la couleur bleue cesse d’être simplement un phénomène optique pour devenir un élément sensoriel et culturel à part entière.
Bleu : histoire d’une couleur
Michel Pastoureau retrace la complexité de l’expérience de la couleur grâce aux pratiques habituelles ancrées dans la vie quotidienne et matérielle : la teinturerie et les modes vestimentaires, le langage, les pratiques picturales, les rituels et la liturgie, le droit et les réformes politiques. S’ajoute à ces domaines, une histoire scientifique et visuelle des couleurs. Finalement, l’analyse de Michel Pastoureau montre que la couleur bleue est surtout liée à des problèmes de fabrication, des problèmes sociologiques et idéologiques dont le système de classement est dépendant de tendances et d’habitudes culturelles collectives.
Le bleu ne fait pas de bruit, c’est une couleur sans arrière-pensée qui apprivoise le regard, le laisse venir pour qu’il s’enfonce est se noie sans se rendre compte de rien. Il est propice à la disparition. […] Il s’agit d’une résonnance spéciale de l’air, un climat, une teinte née du vide et ajouté au vide aussi changeant dans la tête de l’homme que dans les cieux. L’espace que nous traversons est ce bleu terrestre invisible qui fait corps avec nous.
Maulpoix, Une histoire du bleu, 1992
✏️ N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Je serai ravie de découvrir d’autres lectures d’histoire de l’art pour débutants ainsi que vos impressions pour enrichir cette exploration.
✨ Envie de poursuivre la lecture ? Je vous invite à lire cet article pour approfondir ce sujet : Quels livres pour s’initier à l’Histoire de l’art ?
👉 Restez connectés à l’actualité de Place Plume sur Instagram et Facebook, et abonnez-vous à la newsletter du blog dans le menu à droite de votre écran. Vous recevrez toutes mes astuces et mes conseils en rédaction une fois par mois dans votre boîte mail.
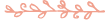
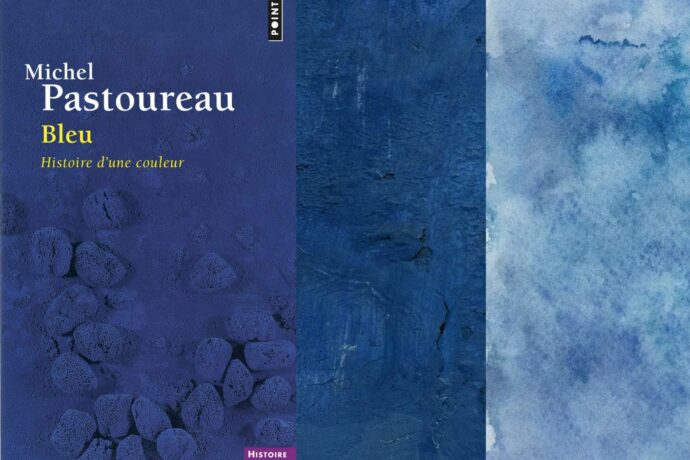
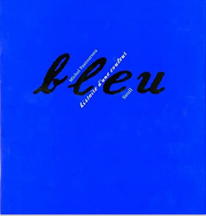

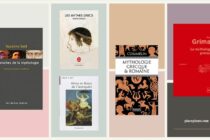
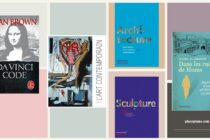
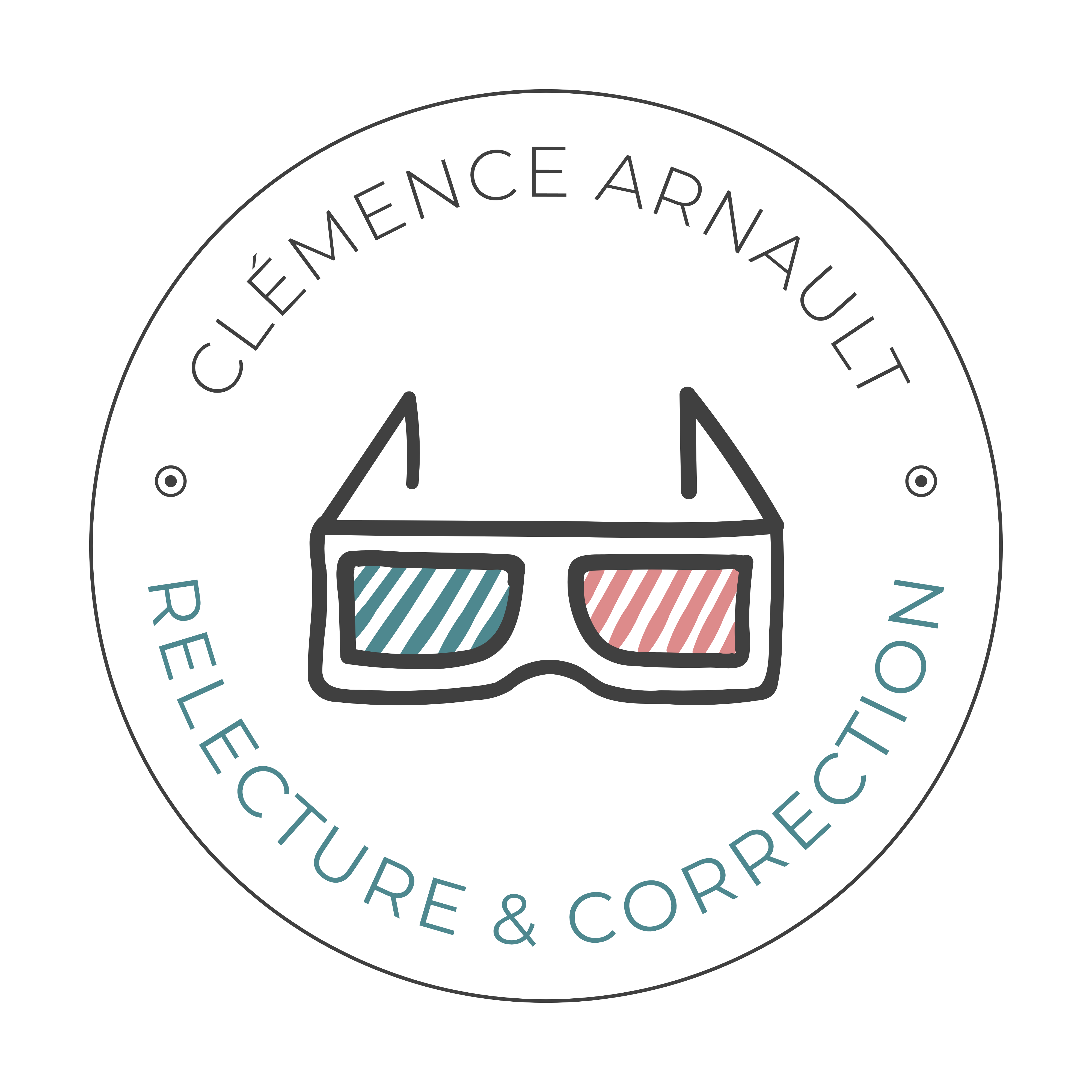
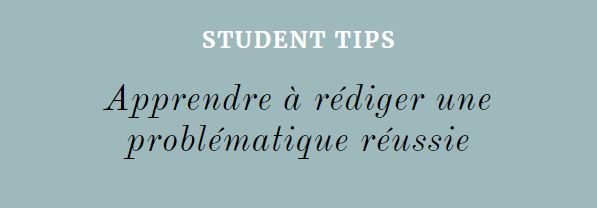
0 Comments