Faire un doctorat ou pas : un dilemme qui hante de nombreux esprits passionnés. Au-delà de sa simple définition administrative, le doctorat transcende la vie universitaire pour devenir un défi de chaque instant. Il n’est pas simplement question de rédiger une thèse, mais plutôt de vivre et respirer son sujet de recherche au quotidien. Les clichés de l’Indiana Jones académique ou du rat de bibliothèque ne capturent qu’une facette de cette aventure complexe. Derrière ces images, se cachent souvent une passion profonde et une aspiration professionnelle claire : celle de devenir enseignant et/ou chercheur.
Vous trouverez beaucoup d’articles définissant le doctorat, du plus administratif au plus émotionnel. Plongeons ensemble dans l’essence de cette expérience humaine unique, explorant non seulement son fonctionnement interne mais aussi les motivations profondes qui poussent tant d’individus à entreprendre une thèse. Pourquoi choisir cette voie exigeante et gratifiante à la fois ? Examinons de près les raisons qui incitent à se lancer dans l’aventure.
Pourquoi se lancer dans une thèse ?
Le doctorat est un moment intense qui demande beaucoup de travail : recherches, analyse, rédaction, séminaires, colloques, séjours d’études, charges de cours, publications, formations doctorales… ce sont autant de tâches qui requièrent une attention particulière en plus de notre sujet de thèse. Du coup, à peu près tous les sentiments bons comme mauvais se mélangent et ça prend parfois la tête.
Du sang, des larmes et de la sueur…
C’est ce que mon directeur de recherche avait l’habitude de dire lors de son premier entretien pour définir l’expérience. Et c’est vrai. La thèse rythme notre quotidien pendant les 4 ou 6 années suivant notre inscription, surtout en Sciences Humaines. C’est donc quelque chose qui se pense en amont et doit être envisagé stratégiquement.
Plus qu’un exercice académique, le doctorat est un moment de vie.
Quelques mois après sa soutenance, une thèse évoque surtout de la fierté. Celle d’avoir accompli quelque chose dont on ne se pensait peut-être pas capable et celle d’être docteur(e).

Le travail du doctorant est-il visible ?
Le travail de thèse demeure en grande partie invisible jusqu’à son impression. Il ne se limite pas non plus à la simple réalisation de la thèse. Il faut participer à des colloques pour se faire connaître, pour montrer ce que l’on fait, voire tester nos hypothèses. Les charges de cours sont obligatoires, non seulement pour l’expérience, mais aussi pour pouvoir être qualifié.e à la fin. Bref, pour se forger un « après », il faut accomplir pas mal de choses, qu’elles soient visibles ou invisibles et liées de près ou même de loin à notre travail.
En thèse, on développe de nombreuses compétences. C’est riche et varié : apprendre à rédiger, à analyser, à se présenter, à critiquer, à se mettre en valeur, à travailler dans un temps imparti (même s’il se compte en années). On rédige des publications scientifiques, on prépare des cours intéressants ou des communications, on participe à des colloques… Enfin, je ne compte plus les nombreuses compétences que l’on acquiert en diplomatie, en communication, en pédagogie, en langues, en rédaction, en organisation ou en autonomie, etc. etc.
Un statut « hybride », coincé entre deux chaises…
Le doctorant se trouve à mi-chemin entre l’étudiant et le professionnel, selon ce qui arrange les autres, mais rarement selon nos propres préférences. En général, nous sommes bien perçus par les étudiants, souvent les doctorants sont ceux qui dispensent les travaux dirigés (TD) et sont donc les plus proches des étudiants. Avec les professeurs, c’est variable. Certains nous apportent leur soutien et nous encouragent, tandis que d’autres nous regardent de haut et nous rappellent constamment les rapports hiérarchiques.
Pour la société en général, les perceptions varient également. Certains sont impressionnés par notre démarche, d’autres moins, avec l’image persistante de l’éternel étudiant. Il existe aussi un problème spécifiquement français, où pour la société, un docteur est souvent associé à un médecin, ce qui entraîne une méconnaissance de notre titre après la soutenance, du fait que nous ne sommes pas médecins. Les doctorats en Sciences Humaines et Sociales sont généralement moins valorisés.
Quelles sont les qualités requises pour faire une thèse ?
En réalité, la motivation et la passion sont deux qualités primordiales pour se lancer dans une thèse. Sans elles, accomplir une thèse, surtout en Sciences Humaines et Sociales (SHS) où la durée moyenne est d’environ 5 ans, devient complexe.
Il faut véritablement de la ténacité pour tenir sur le long terme. Il est nécessaire de savoir rebondir, faire face à l’ennui ou à la lassitude, en particulier en fin de thèse, et affirmer ses opinions. La clé réside également dans une communication régulière avec son directeur. Il ne faut pas craindre de lui exprimer ses ressentis.
Au-delà de la ténacité, on pourrait parler de témérité. Se lancer dans une thèse et persévérer tout en assumant ses choix demandent du courage. Entreprendre une thèse en histoire exige une grande confiance en soi et une volonté inébranlable. Il est essentiel de savoir dès le départ où l’on met les pieds et de définir une ligne de conduite solide, tout en gardant une conscience aigüe des enjeux professionnels.
Combien de temps dure une thèse ?
Les thèses en Sciences Humaines sont connues pour être longues. Elles impliquent un processus étendu de collecte de données et de documentation, allant des archives et ouvrages aux travaux de terrain, aux sources anciennes et à la documentation visuelle, entre autres. Ensuite, vient le traitement des données, suivi de la rédaction, souvent avec plusieurs centaines de pages et un volume similaire pour les annexes.
Une thèse standard en Histoire de l’art s’étend généralement sur 5 à 6 ans. La rédaction compte entre 300 et 350 pages, accompagnée de 2 à 4 volumes d’annexes de 50 à 200 pages en moyenne.
Parallèlement, de nombreux doctorants en SHS ont un emploi alimentaire en parallèle et/ou enseignent.
Comment surpasser l’envi d’abandonner ?
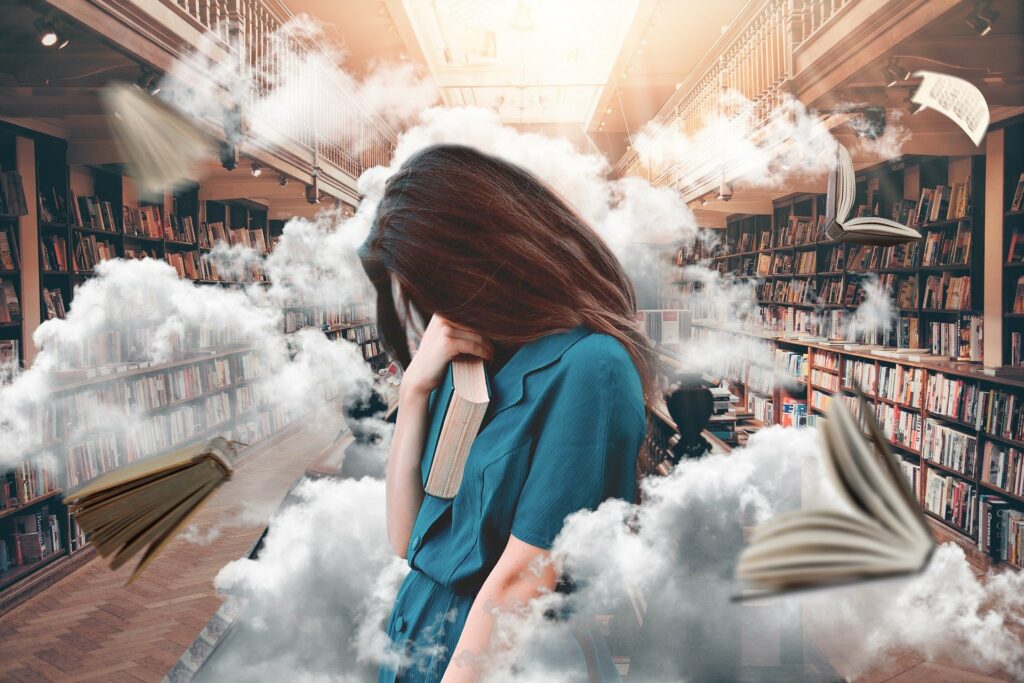
Pendant la thèse, l’envie d’abandonner peut surgir fréquemment. Ce parcours est jalonné de hauts et de bas, et ces moments creux peuvent susciter le désir d’arrêter. C’est tout à fait normal, et cela constitue toujours une occasion de remise en question, pas nécessairement dans un sens négatif.
Lorsque l’on se questionne sur le sens de son travail, c’est un bon signe. Cela offre l’opportunité de réévaluer nos attentes, de trier nos hypothèses, de faire le point, de ranger nos dossiers, voire de prendre la décision de mettre fin au projet.
La réorientation n’est pas forcément un échec…
Quand ça arrive, il faut en parler. Que ce soit en appelant une amie, en contactant son directeur de recherche ou en échangeant avec ses proches, il est préférable de ne pas laisser la frustration ou le blocage s’installer. Un soutien joue un rôle primordial pour prendre des décisions éclairées. Dans tous les cas, je considère qu’une réorientation n’est jamais un échec. Au contraire, elle offre l’opportunité d’apporter des ajustements bénéfiques à ses projets.
Quel est le rôle du directeur de recherche ?
Le directeur de recherche est la personne qui encadre ta thèse : il est là pour te guider, t’aider, te relire, t’orienter, etc. Le choix de cette personne est crucial. Non seulement son domaine d’expertise compte, mais aussi sa réputation. Dès le début, la réputation de ton établissement et de ton directeur de recherche influence tes chances de décrocher un poste. Il faut donc penser de manière stratégique, car tu peux bénéficier de son réseau, de son aura, de sa notoriété… Au début de la thèse, tu essaies surtout de te faire connaître en mettant d’abord en avant ton directeur/ta directrice…
Cependant, la réputation ne doit pas être la seule raison pour choisir un directeur/une directrice : il est également essentiel de bien s’entendre avec lui/elle. N’oublie pas que tu vas travailler pendant de longues années avec cette personne.
A quoi sert l’école doctorale ?
L’école doctorale représente le côté administratif pur et dur du doctorat. En théorie, elle est censée accompagner les doctorants sur les questions administratives. Cependant, dans les faits, il faut souvent les solliciter, voire se déplacer, pour obtenir une réponse. Bien sûr, cet avis n’engage que moi, et il est important de noter que chaque école peut avoir ses propres spécificités. Honnêtement, l’école doctorale est surtout présente pour encadrer les inscriptions, les demandes de financement, les procédures interminables et les demandes de soutenance.
Elle valide ou non les demandes de soutenance et l’obtention des crédits doctoraux. Pour pouvoir soutenir, il faut valider 60 crédits en formations doctorales, communications à des colloques ou publications d’articles… Heureusement, l’obtention de ces crédits devient plus souple. En général, on interagit davantage avec son école doctorale au moment de déposer sa thèse. Je recommande également les associations de doctorants locales pour s’y retrouver.
Le moment de la soutenance entre soulagement et inquiétudes
Que d’émotions, quand c’est ton moment ! Quelle histoire !

La soutenance représente le point culminant de plusieurs années de travail, symbolisant la fin des études et l’obtention du titre de docteur.e. C’est « Ton moment » ! Mais avant cela, c’est surtout une période stressante et longue. L’attente et l’incertitude pèsent, mais une fois le manuscrit déposé, on peut souffler et se concentrer sur les détails administratifs avec l’aide du directeur de recherche et de l’école doctorale.
À un mois de la soutenance, les premiers avis des rapporteurs donnent une idée du discours à préparer. Si la soutenance est envisagée et validée, une grande partie du chemin est parcourue. Le reste dépend de la confiance en soi, de la gestion du stress, et de la préparation mentale et physique. La soutenance elle-même est un moment plaisant, mêlant éloges et critiques.
Dans tous les cas, si la soutenance est envisagée et validée par le directeur, c’est à moitié-gagné. Lors de la soutenance, bien préparée et maîtrisée, le doctorant argumente et soutient son travail. C’est votre travail, c’est votre thèse, quoi que les juges en disent. C’est un moment de discussion qui est plaisant, mais d’une durée significative de plus de quatre heures. C’est un exercice éprouvant qui demande beaucoup d’énergie. À la fin, les sentiments sont divers : étourdi.e, vidé.e, ému.e, léger/ère. On peut alors profiter du moment avec un pot organisé pour ses proches et le jury.
Conclusion
Alors doctorat ou pas doctorat ? Bien plus qu’une simple étape académique, c’est un parcours exigeant, ponctué d’émotions intenses, de moments de doute, mais aussi de passion profonde. Les choix du directeur de recherche, l’importance de l’école doctorale, et les défis de la soutenance forgent cette expérience unique. Au-delà des aspects administratifs, le doctorat offre une immersion profonde dans la recherche, transformant notre compréhension du domaine d’étude et du monde qui nous entoure. Que l’on décide de poursuivre une carrière académique ou de s’aventurer vers d’autres horizons, le doctorat reste une expérience riche en apprentissages, rencontres et découvertes, marquant durablement ceux qui s’y engagent.
Cet article a été rédigé en collaboration avec Flore Lerosier qui est docteure en Histoire de l’art et Archéologie de l’Université de Tours. Elle a bien voulu me raconter son expérience de la thèse dans une interview. Merci à elle !
✏️ N’hésitez pas à partager votre expérience et vos conseils dans les commentaires. Je serai ravie de découvrir vos impressions pour enrichir cette exploration du doctorat.
✨ Envie de poursuivre la lecture ? Je vous invite à lire cet article pour approfondir ce sujet : Vivre d’une thèse en histoire de l’art : rêves vs réalité
👉 Restez connectés à l’actualité de Place Plume sur Instagram et Facebook, et abonnez-vous à la newsletter du blog dans le menu à droite de votre écran. Vous recevrez toutes mes astuces et mes conseils en rédaction une fois par mois dans votre boîte mail.

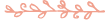




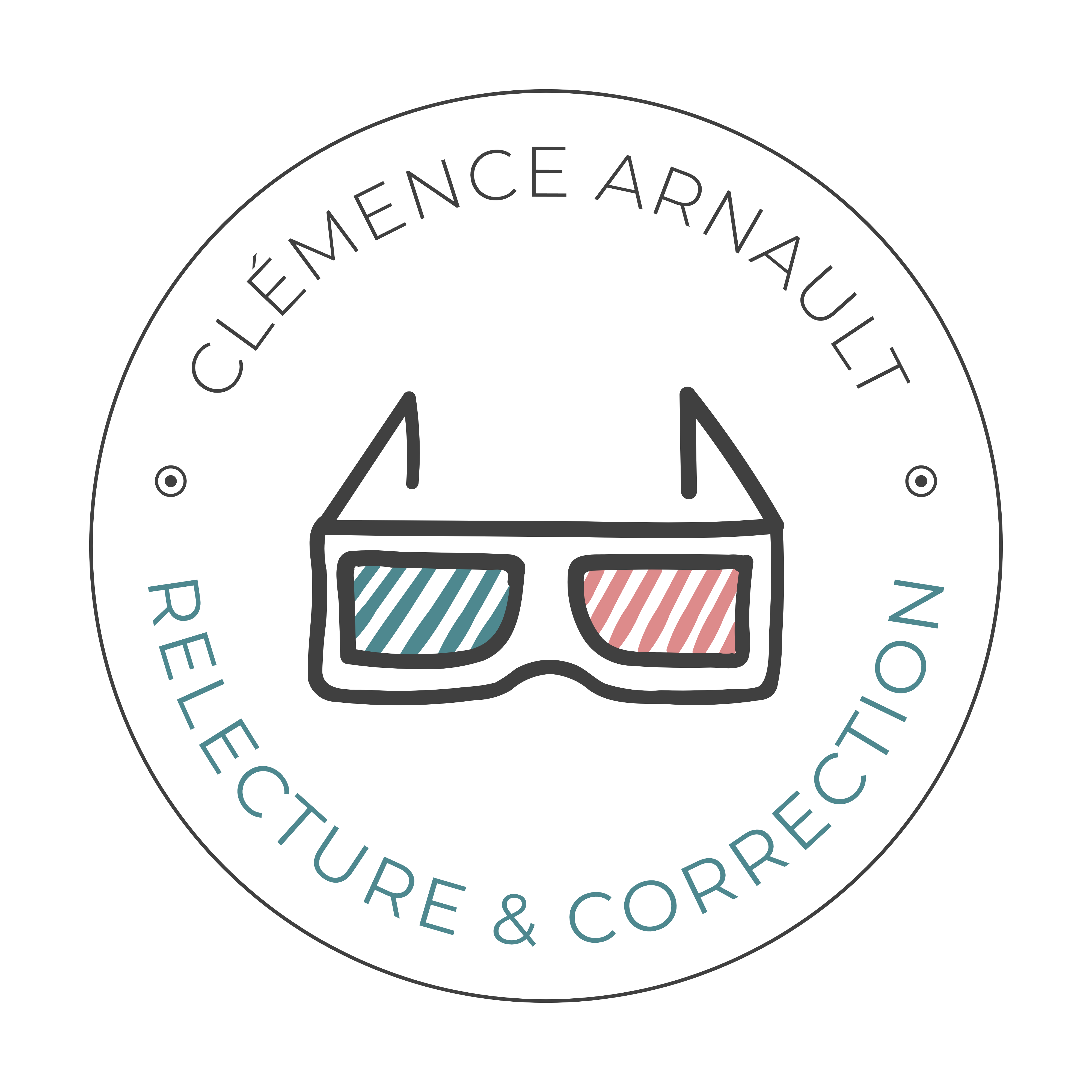
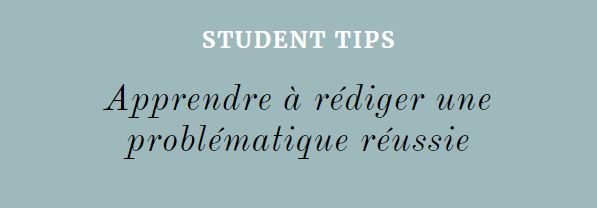
0 Comments