Faut-il vraiment travailler en Histoire de l’art ? N’est-ce pas qu’une planque ? Malheureusement, une fois passée la douce période de rentrée, on se rend vite compte de la somme de travail à accomplir… Alors, comment survivre après la rentrée ? Dans cet article, je partage un peu de mes secrets de prof avec vous pour bien anticiper, et surtout réussir, les principaux exercices académiques : prise de notes, fiches, bibliographies, commentaires d’œuvres, exposés ou encore partiels. Je te propose d’y voir plus clair pour déminer tous les pièges et avoir une bonne routine de travail dès la rentrée. »
👉 À lire également : Comment survivre à la fac et travailler en autonomie ?
1 : Suivre un cours sur le long terme
On ne le dira jamais assez, mais la régularité, c’est la clé. Aussi, quand on parle de suivre un cours, il s’agit également d’apprendre le plan du professeur, de ficher ses notes, de noter des questions, de compléter par des lectures et de prendre de la hauteur sur ce qui a été dit. Ce travail se fait généralement au moment des révisions avant les partiels. Pourtant et selon moi, c’est un peu tard si l’on tient compte des deux petites semaines qui nous sont allouées pour réviser un semestre entier… En général, je conseille de revisiter ses notes après chaque chapitre important de cours. Cela permet de gagner du temps et de réduire le stress au moment des révisions.
Capter l’organisation du cours et la logique du prof !
Ce n’est pas toujours facile. A-t-on affaire à des études de cas, à un déroulé chronologique, à un cours thématique, à un hybride chrono-thématique ou encore à une monographie ? Parfois, c’est carrément la pagaille complète. Pas toujours facile à suivre. Dans ce cas, essayez de repérer les similarités ! Faites des liens !
Pour s’y retrouver, il suffit parfois de prendre un exemple ou une grande notion dans le cours et de développer autour de cela. Accroche-toi à ce que tu peux. Liste au maximum les notions, les résultats observés, leur domaine d’application (période, contexte, historique, date), le vocabulaire, les œuvres ou artistes associés, l’historiographie !
Apprendre le plan du cours pour gagner du temps
Le plan du cours, c’est la précieuse feuille distribuée en début de semestre et à conserver absolument ! C’est ton fil d’Ariane, ta bouée de survie sur laquelle tu vas baser ta routine de travail (notes, fiches, lectures). Le prof n’en donne pas ? À toi d’en créer un ! Montre ta capacité à synthétiser et à apprendre !
✨ À la fin du semestre, retrouve ce plan – il est généralement froissé au fond d’un classeur – redivise-le par grands titres, note les idées et les concepts, les définitions, un ou deux exemples pertinents, les dates ainsi que un ou deux auteurs. De plus, pour 100 pages de cours, synthétise 10 à 15 pages de fiches recto verso. Réduis, digère, intègre… choisis la métaphore que tu préfères pour sélectionner la bonne information, la mémoriser, et l’assimiler !

À quoi ça sert de ficher mes cours ?
C’est juste La base. La fiche t’aide à retenir les termes appropriés et leurs usages. Elle te permet de répertorier les œuvres à connaître avec leurs périodes de création et leurs auteurs. Tu peux également y ajouter une liste d’ouvrages incontournables pour le cours. Enfin, la fiche te permet d’organiser ton cours, et ainsi, tu te retrouves dans la somme d’informations collectées.
Ficher, c’est donner du sens et de la logique avant les révisions
N’attendez pas les révisions. C’est une période trop serrée pour tout ficher et faire le tri dans le cours. Et oui, tu ne pourras pas tout digérer en seulement 2 ou 3 semaines de révisions, surtout si le cours est un fouillis pas possible. Attendre les révisions est une méthode très dangereuse, j’en ai déjà fait les frais.
Fragmente ton « fichage ». Ce n’est pas forcément utile à la fin de chaque cours… mais à la fin de chaque grand thème ou chapitre, oui ! Par gros blocs de cours en ajoutant tes lectures complémentaires… »
Ma méthode de « fichage » :
✨ Notez, pour chaque période, les termes pertinents, leur utilisation, la date, une ou deux œuvres à titre d’exemple et un auteur à citer. Au verso, indiquez les grandes notions et le vocabulaire associé, et au recto, les exemples, les artistes, les comparaisons.
La fiche est une manière de revoir son cours facilement. Elle permet de compiler, d’illustrer et de créer des liens. Enfin, n’oubliez pas de noter des idées de problématiques sur vos fiches. C’est très utile pour le jour des partiels.
👉 Être productif et créatif : 8 conseils pour bien s’organiser à l’Université
2 : Décrypter une bibliographie
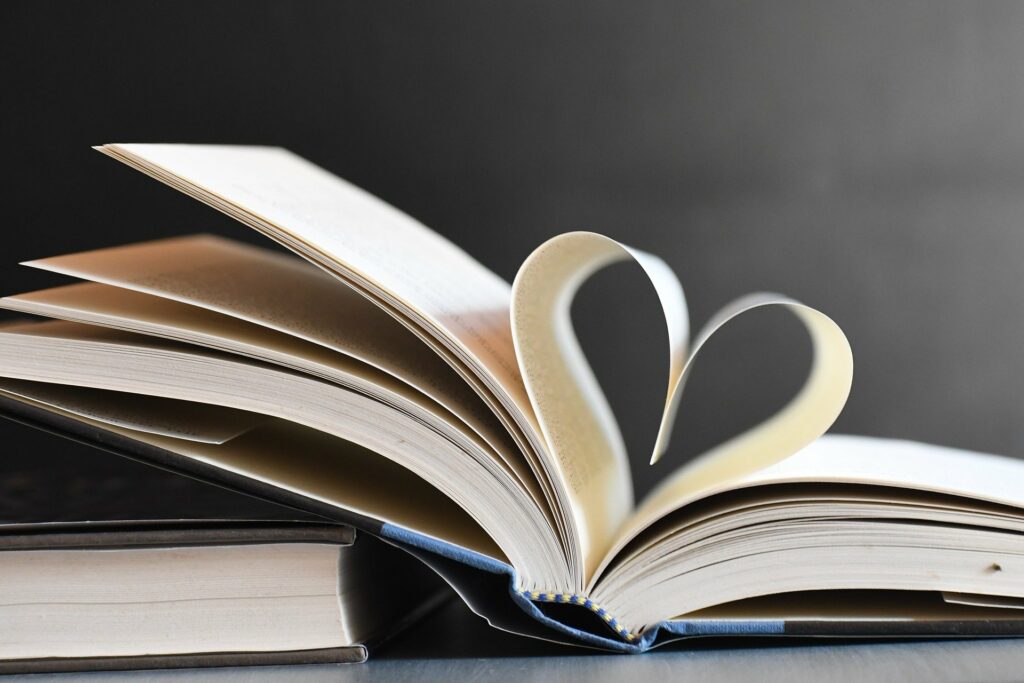
La bibliographie, c’est l’autre précieuse feuille qu’on te distribue au début du semestre avec le plan du cours. Les deux feuilles fonctionnent ensemble. Numérise-les, photocopie-les… bref, ne les perds pas !
La bibliographie est une liste d’ouvrages associés aux notions vues en cours. Certains sont obligatoires (même si le prof ne le précise pas), d’autres sont à consulter par toi-même pour approfondir le cours et préparer tes exposés.
✨ Pour autant, ne fais pas de zèle. Choisis malin. Sélectionne en premier lieu les ouvrages « préférés » du prof (il en parle souvent en cours). Choisis 3 ou 4 ouvrages d’auteurs incontournables pour compléter. Enfin, choisis 1 ou 2 ouvrages « détente » de ton cru. N’hésite pas à demander conseil au prof ou au moniteur de bibliothèque.
Enfin, n’oublie pas de ficher tes lectures et de toujours noter les références !
3 : L’art du commentaire d’œuvre
Le commentaire de document est un exercice mobilisant ta capacité à reconnaître, comprendre, décrire, problématiser et analyser un document. Son objectif est de combiner, d’une part, des éléments contextuels du sujet (période, histoire politique, culturelle et économique, styles, évolutions…) et, d’autre part, une étude symbolique et/ou iconographique de l’objet grâce à une description étayée d’une analyse. Tu es perdu ?! Allez, on s’accroche…
Le commentaire doit être guidé par une méthode rigoureuse et complète comprenant une introduction, une description, un développement et une conclusion. Ces quatre parties sont reliées par une problématique, qui a pour fonction de soulever l’intérêt, les enjeux, les axes majeurs d’un document. Dans cet exercice, les jugements d’ordre personnel ou esthétique sur le document sont déconseillés.
👉 Comment rédiger une problématique réussie ?
4 : Réussir un exposé oral en quelques mots
Un bon exposé oral requiert au moins deux choses :
– une bonne répartition de son travail de recherche dans le temps
– une bonne application de la technique du commentaire
Si ton travail est impeccable, la gestion du stress pour l’oral sera d’autant plus simple. Pour choisir ton sujet, j’ai également deux conseils : ne le choisis pas trop tôt dans le semestre, mais évite aussi de le faire à la fin. Ensuite, opte pour un sujet qui te semble intéressant, plaisant, qui t’étonne. Cultive ta curiosité pour un sujet et non le dépit.
La préparation de ton sujet doit te prendre 4 à 6 semaines (pas à temps complet). Il faut compter un temps de lecture et de fichage, un temps de synthèse et de montage, un temps de rédaction, et enfin de répétition et de finition.
Enfin, le jour J, moins, c’est toujours mieux. Ton diaporama doit être le plus simple possible, sans fioriture. Le discours doit être clair et audible. Branche le micro, ça sauve la vie. Imprime ou affiche ton discours écrit en gros caractères. Enregistre ton visuel sous plusieurs versions. Tu peux même arriver un peu avant pour le tester sur l’ordinateur. N’oublie pas de respirer pour ne pas parler trop vite !
5 : Dominer les partiels
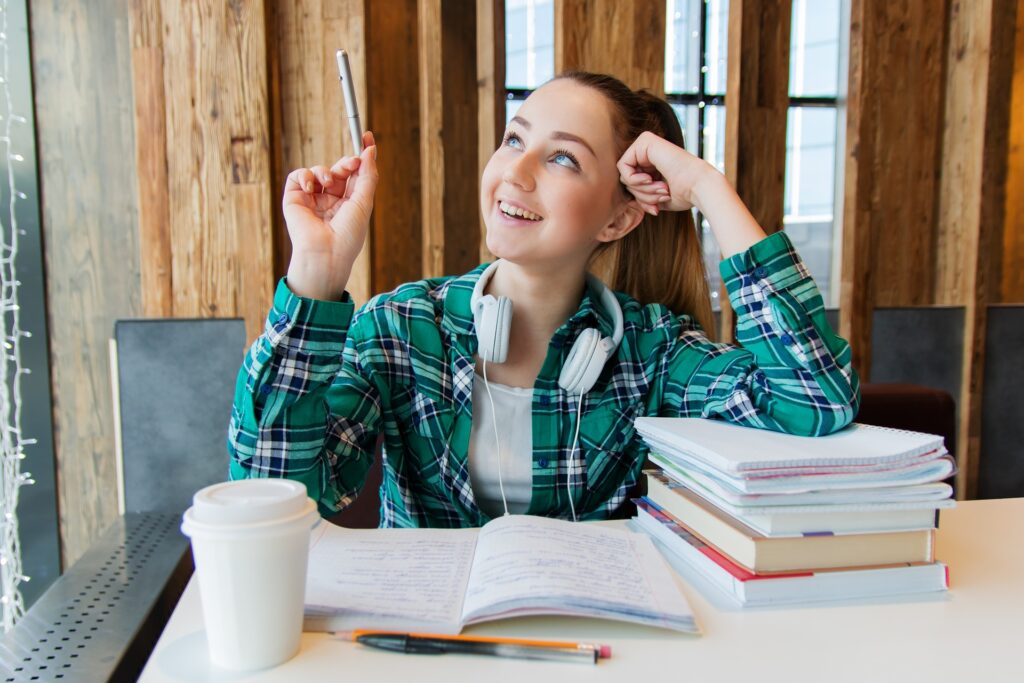
Après une brève (trop brève) période de révisions et de rabâchage quotidien de fiches, arrivent les partiels. Ce moment tant redouté, mais qui, une fois démystifier, n’est plus qu’une simple routine à chaque semestre.
Comment rater à coup sûr ces partiels ?
Voici ma méthode infaillible pour ne pas valider son semestre aux partiels : cumuler les fautes de français, éviter à tout prix l’utilisation de termes techniques, ne pas mentionner les notions vues en cours dans son discours, ne pas fournir d’œuvres en exemple pour la comparaison, omettre les dates et les auteurs. Enfin, si l’introduction est ennuyeuse, la conclusion bancale et ta technique du commentaire expéditive, c’est encore mieux.
Comment réussir les partiels ?
Réussir un partiel, c’est réussir son brouillon avant toute chose. Lorsque j’étais en Licence 2, l’un des profs de médiéval demandait toujours le brouillon de l’épreuve avec la copie pour sa notation. Depuis, je soignais autant le brouillon que le rendu.
Aussi, il ne faut pas avoir peur de demander des feuilles de brouillon : 5, 6… Il n’en manque pas. Compte une feuille par partie rédigée : introduction, parties 1, 2, 3, 4… et conclusion. Enfin, une feuille de brouillon s’utilise recto verso. Comme pour tes fiches, utilise le recto pour les grandes notions vues en cours et le verso pour les exemples d’œuvres.
Enfin, on décortique le sujet sans précipitation. On le lit plusieurs fois (même à voix haute, pas trop fort…). Puis, on souligne les mots-clés (si, si… on est plus en CE1, mais ça ne fait rien). Ensuite, on note les termes que cela évoque avec leur définition, on note toutes les notions que l’on se rappelle du cours et des lectures. On note des artistes et des œuvres pour les comparaisons. Enfin, on reformule tout ça sous forme de question pour trouver une problématique. Pas mal non, tu en penses quoi ?
👉 120 minutes pour structurer une copie de partiel
✏️ N’hésitez pas à partager vos conseils dans les commentaires. Je serai ravie de découvrir vos impressions pour enrichir cette exploration.
✨ Envie de poursuivre la lecture ? Je vous invite à lire cet article pour approfondir ce sujet : Éviter le naufrage : déconstruire les clichés et comprendre la méthodologie universitaire
👉 Restez connectés à l’actualité de Place Plume sur Instagram et Facebook, et abonnez-vous à la newsletter du blog dans le menu à droite de votre écran. Vous recevrez toutes mes astuces et mes conseils en rédaction une fois par mois dans votre boîte mail.
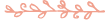




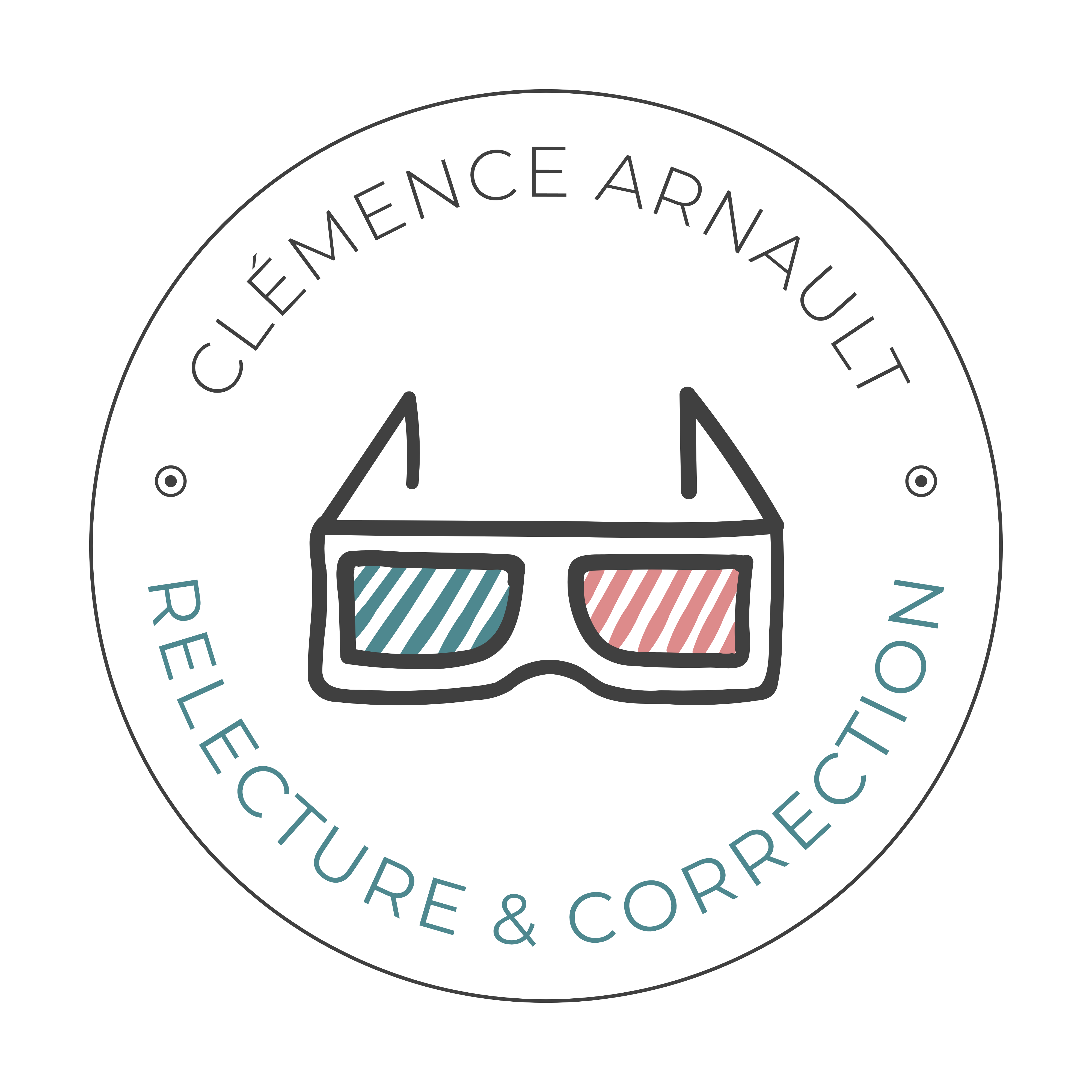
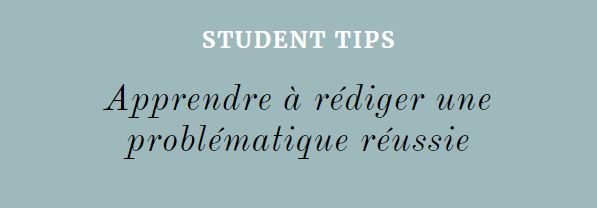
0 Comments