Vivre d’une thèse en histoire de l’art, ça fait rêver. Et pourtant, la réalité peut vite se charger de briser nos plus belles espérances. Il est tentant de s’imaginer un avenir bien tracé, défilant en star des colloques, dirigeant un laboratoire ou captivant un amphithéâtre bondé en tant que maître de conférences. Cependant, la chute est brutale, une fois les premiers refus de financements essuyés. Alors, comment éviter que notre thèse ne se transforme en source de frustration et d’amertume ? Au-delà des fantasmes, cet article propose d’affronter les questions à se poser avant et pendant la thèse. Confrontons-nous à ces aspects moins glamours et trouvons des stratégies pour que votre thèse soit une expérience enrichissante plutôt qu’une source de désillusion. Âmes sensibles s’abstenir…
😱 Il y a-t-il des débouchés après une thèse en Histoire de l’art ?
C’est à vous de rendre votre profil « introuvable » en choisissant les bonnes spécialités dans les meilleurs établissements et/ou laboratoires de recherche suivis par le ou la meilleure des directeurs de recherche.
La thèse est une porte d’entrée vers la recherche, tous les domaines confondus. On retrouve ainsi des métiers tels qu’enseignant-chercheur, ingénieur de recherches, enseignant dans le secondaire, et tout ce qui concerne les carrières universitaires.
En réalité, ce n’est pas si simple. Les opportunités sont véritablement rares, nécessitant une réflexion approfondie en amont, car la concurrence est féroce et les chances de succès lors des processus de recrutement sont relativement faibles. Il est impératif de prendre conscience de cette réalité avant de s’engager dans une thèse, et cette prise de conscience peut être l’aspect le plus difficile à assimiler. Le choix de poursuivre un doctorat doit être stratégique, idéalement combiné à un parcours plus orienté professionnel. Les postes disponibles en histoire de l’art sont peu nombreux, et les recrutements difficiles…
On peut vite se retrouver isolé(e) après cinq années de travail intense, sans perspective professionnelle ni vision claire, comme en témoignent les données suivantes pour l’année 2020 :
- – 20 160 étudiants inscrits en doctorat en Sciences Humaines et Humanités
- – 13 915 diplômés, parmi lesquels 2 673 sont docteurs en Sciences Humaines et Humanités
- – Seuls 15 postes de maître de conférences étaient disponibles dans la section Histoire de l’art
- – Envisager 1 à 2 postes selon notre profil, matière, spécialité…
Chiffres donnés pour l’année 2020 par Statista.com.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : près de 2000 personnes qualifiées vont postuler pour un nombre limité de postes. Face à cette réalité, la question légitime se pose : pourquoi entreprendre une thèse dans ces conditions ? Le moteur essentiel de la thèse demeure et restera la passion pour la recherche ou la pédagogie. Le doctorat, en tant qu’atout professionnel, permet le développement et le renforcement de compétences clés. L’expérience en elle-même est riche et formatrice. Pour ceux aspirant au métier de maître de conférences, il demeure le seul moyen d’y accéder, nécessitant ainsi la construction d’un profil « hors-du-commun » pour se démarquer dans un marché compétitif.
🤯 Comment définir ces objectifs métiers ?
Quand on se lance dans une thèse, l’objectif est une carrière universitaire.
Les années consacrées à la thèse offrent une opportunité de se familiariser avec l’enseignement, et pour beaucoup d’entre nous, cela devient une véritable révélation. Ainsi, en plus de la recherche, l’enseignement propose une profession non routinière. Outre les cours, il y a des opportunités de voyager, de publier des articles, de participer à des journées d’études, de contribuer à l’ouverture scientifique, et de rencontrer des individus exceptionnels – une sorte de métier-passion.
Cependant, il est essentiel de prendre conscience que l’obtention d’un poste est extrêmement difficile. Je me répète volontairement, car plus que de la passion et un bon profil, ce parcours exige également une part de chance.
Nos objectifs sont à définir avant de commencer une thèse, et même avant d’entrer en Master. Souvent, la découverte de la recherche se fait au cours du Master, et l’on poursuit dans cette voie emporté par le courant, bercé d’illusions, avec l’idée d’un poste assuré à la fin. C’est une erreur ! Il est crucial de planifier son doctorat avec un esprit clair, même si la projection peut sembler difficile.
Le doctorat est une expérience toujours à portée de main, à tout moment, même en validation d’acquis ! Il est plus simple d’y retourner avec un bagage pro’ que de faire machine-arrière en cours de route.
Pour définir vos objectifs, prenez rendez-vous avec l’un de vos professeurs (même si cela peut paraître complexe), discutez-en avec vos camarades, sollicitez des associations de doctorants, explorez le sujet sur les forums et autres groupes sur les réseaux sociaux, et demandez des conseils à vos chargés de TD, qui sont souvent des doctorants !
Allez chercher des informations, posez des questions, même les plus difficiles. Il est également possible d’aborder ces questions lors de votre premier entretien avec votre futur directeur de recherche. C’est un moment propice pour réfléchir et envisager l’avenir avec quelqu’un du métier.
🥶 Les charges de cours sont-elles suffisantes pour vivre ?
Malheureusement, non, l’enseignement ne suffit pas pour vivre. La majorité des doctorants interviennent en qualité de vacataires. Ils ne sont pas titulaires et ne sont pas rattachés de façon permanente à l’Université. Cette situation est quelque peu précaire et ambiguë. En termes simples, il s’agit de « contrats » pour de petits services tels que des tutorats ou des travaux dirigés. Généralement, le paiement intervient plus de six mois après la prestation des cours, avec des procédures administratives souvent longues. Le doctorant est rémunéré deux fois par an, uniquement s’il dispense des cours sur les deux semestres.
Ensuite, il y a les ATER (Attaché Temporaire à l’Enseignement et la Recherche) recrutés sur concours. Ces derniers ont un salaire convenable pendant 12 mois, ce qui permet de subvenir à ses besoins sans trop de difficultés. Néanmoins, ce type de contrat est soumis à l’ouverture hypothétique d’un poste par l’Université et limité dans le temps avec une durée de 2 à 3 ans sous conditions.
Enfin, les contractuels sont les seuls à bénéficier d’une rémunération stable, mais difficile d’accès. Ce sont des contrats de 10 mois non payés en juillet et août (il faut donc s’organiser). Les heures de cours peuvent varier entre 192 et 386 heures, avec un salaire brut mensuel oscillant entre 1800 et 3500 euros. Cependant, trouver des postes disponibles à pourvoir demeure un défi en soi.
😨 Comment financer une thèse ?
Dans la plupart des cas, il faut se débrouiller pour vivre décemment pendant ses recherches. De nombreux doctorants ne travaillent pas sur leur thèse à temps plein. La passion seule ne nourrit pas, malheureusement.
L’idéal est d’obtenir un contrat doctoral. Dans ce cas, votre école doctorale finance votre thèse à hauteur de 1 400 euros nets par mois durant 3 ans. Il s’agit d’un contrat de travail dédié aux doctorants, sans condition d’âge ou de nationalité, renouvelable deux fois pour un an, totalisant ainsi une durée de 5 ans.
Malheureusement, il n’y a bien souvent qu’un seul contrat pour 1/3 des candidats en SHS. C’est donc très peu, et au-delà de la concurrence, on ne peut postuler qu’une seule fois au concours. Il est donc essentiel de bien se préparer et de présenter un projet de thèse solide. Cela génère déjà une pression considérable. Heureusement, de nombreuses associations de doctorants proposent des entraînements pour présenter efficacement son projet de thèse, et il ne faut pas hésiter à solliciter l’aide de son directeur de thèse.
Le contrat doctoral finance 3 ans de thèse. C’est peu, car une thèse en SHS dure entre 5 et 8 ans. Ensuite, si la thèse se prolonge, il faut trouver d’autres moyens de financement (contrat, partenariat, job alimentaire). La bonne nouvelle, c’est que le contrat doctoral donne droit à des indemnités de chômage qui peuvent être utiles pour terminer.
Conclusion
En résumé, bien que cet article mette en lumière les réalités parfois ardues qui accompagnent le doctorat en histoire de l’art, il célèbre également le courage de ceux et celles qui ont fait ce choix. Le doctorat représente une aventure intellectuelle remarquable, mais les challenges économiques et les perspectives professionnelles incertaines nécessitent une approche stratégique. Bravo à tous les doctorants qui se lancent dans cette extraordinaire exploration du savoir, et à ceux qui hésitent encore, l’invitation est à penser de manière stratégique avant de s’engager dans cette voie passionnante.
✏️ N’hésitez pas à partager votre expérience et vos conseils dans les commentaires. Je serai ravie de découvrir vos impressions pour enrichir cette exploration du doctorat.
✨ Envie de poursuivre la lecture ? Je vous invite à lire cet article pour approfondir ce sujet : Doctorat ou pas doctorat : ce qu’il faut savoir de l’expérience.
👉 Restez connectés à l’actualité de Place Plume sur Instagram et Facebook, et abonnez-vous à la newsletter du blog dans le menu à droite de votre écran. Vous recevrez toutes mes astuces et mes conseils en rédaction une fois par mois dans votre boîte mail.
🤗 Merci à Flore Lerosier qui a bien voulu m’aider à répondre à ces questions difficiles, néanmoins incontournables de l’expérience doctorale.

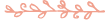




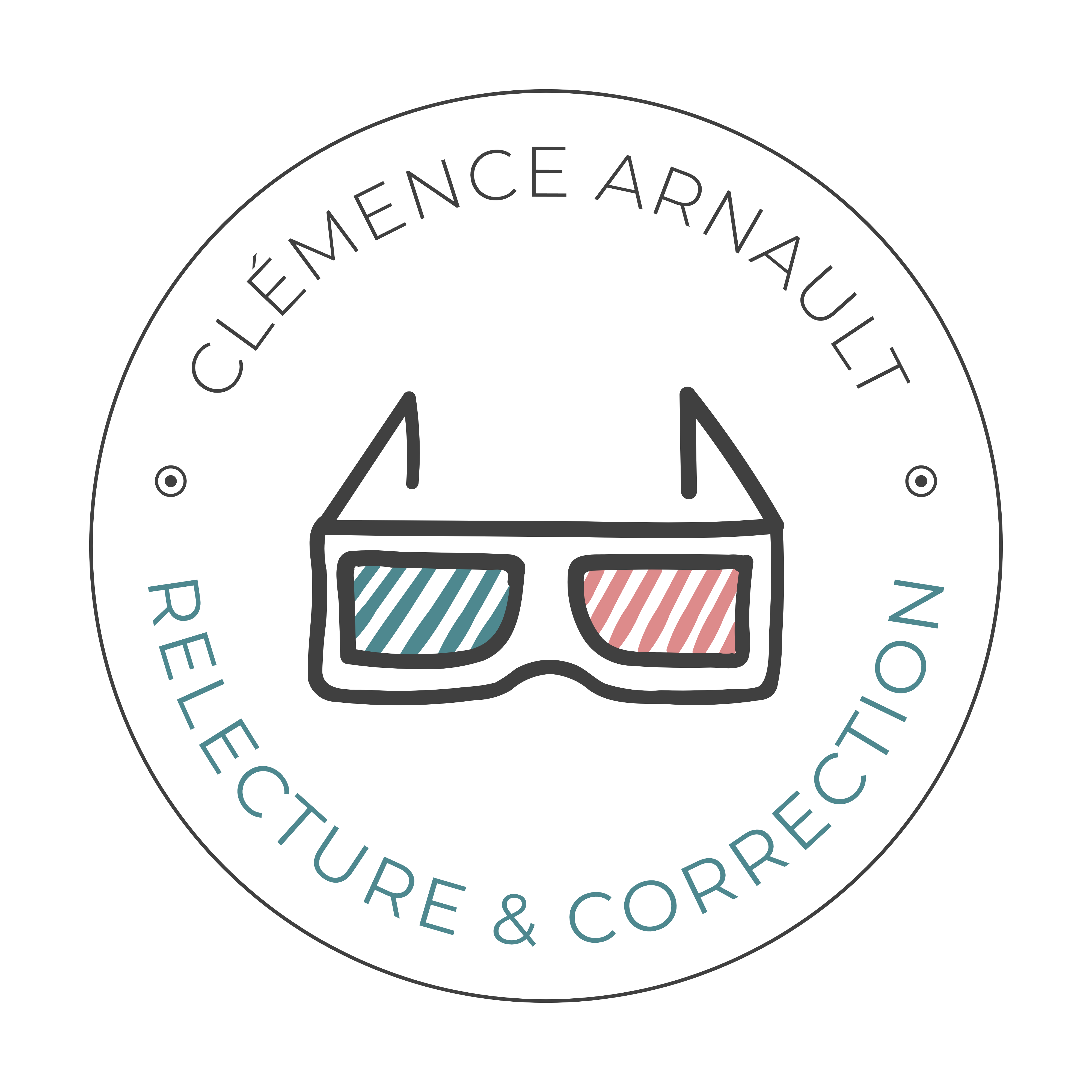
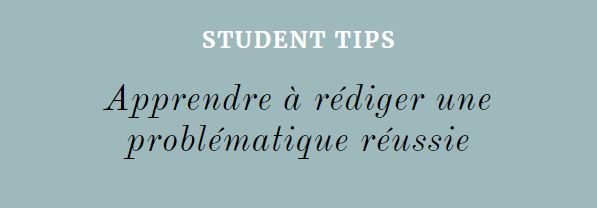
2 Comments
Lauren
Enfin quelqu’un qui dit les choses honnêtement ! Merci.
Je souhaite me lancer dans une thèse en histoire de l’art mais seul problème pas de maitre de recherches.
Je suis en totale panique depuis 6 mois car j’ai pas de contacts ou de réponses et pas de plan B pour le moment.
Trouver un directeur de thèse est pas évident et un aspect dont personne ne parle… ni même de la suite.
Clémence
Bonjour Lauren, merci pour ce commentaire ! Pour répondre à vos interrogations, essayez de contacter les écoles doctorales de votre spécialité. Appelez-les, c’est plus efficace. Elles disposent également de listes de directeurs potentiels et parfois de sujets soumis par un professeur pouvant bénéficier d’un financement. En ce qui concerne les professeurs, continuez à les contacter. Il faut vraiment relancer et relancer. Les professeurs d’université sont connus pour répondre tardivement aux courriels, et parfois même pas du tout. C’est très dommage, et ce n’est effectivement pas normal. Essayez également de contacter les directeurs de filières Master de votre spécialité. Peut-être pourront-ils servir de relais, vous recommander ou créer un contact ? Déplacez-vous à l’université pour discuter avec le secrétariat de la spécialité. Ils peuvent aussi servir de relais. Avez-vous un projet de thèse bien défini avec un argumentaire ? Il est important de proposer des choses précises, même si elles évoluent ensuite. Désolée pour ce message long, c’est effectivement un sujet important qui mériterait un ou plusieurs articles. Bonne chance !