Vous souhaitez devenir maître de conférences, et gravir les échelons jusqu’au séduisant titre de professeur des universités en France ? Découvrez mon décryptage des qualifications : l’étape obligatoire pour devenir maître de conférences après l’obtention d’un doctorat. Ces évaluations annuelles, qui se déroulent généralement de septembre à décembre, représentent un enjeu décisif pour les candidats. Cependant, l’obtention du précieux titre n’est pas garantie et nécessite une compréhension approfondie des critères et des attentes. Dans cet article, nous explorerons en détail les différents aspects des qualifications des maîtres de conférences en France pour ceux qui rêvent d’une carrière académique.
Comment fonctionne le recrutement dans le supérieur ?
Veille attentive des publications et des calendriers
Les postes vacants et ouverts au recrutement dans une université française sont publiés (parfois à temps, parfois non) sur le site : « Galaxie des personnels du supérieur« . Une fois par an, entre le mois de février et de mai, vient le temps des présentations analytiques et des candidatures dématérialisées qui facilitent aujourd’hui grandement les choses, au-delà du bouche-à-oreille et des commérages des années passées.
Votre long parcours, résumé en une petite trentaine de pages, est ensuite « examiné » par des rapporteurs, et dans l’intervalle, vous vous préparez déjà pour les auditions et les autres « joyeusetés » qui vous attendent pour convaincre un jury d’une petite dizaine de personnes que vous êtes le collègue idéal.
👉 Comment rédiger une présentation analytique ?
Devenir maître de conférences en France
Le recrutement des agents de l’enseignement supérieur suit une hiérarchie bien définie dans le temps et l’espace. Il faut être réactif pour arriver au bon moment, être toujours sur le qui-vive et constituer un dossier plus que solide. Pour les professeurs d’université, c’est à peu près pareil. Leur recrutement suit le même parcours, avec des concours comprenant des auditions et des classements basés sur les qualifications et les HDR.
Le monde de l’enseignement supérieur est un microcosme unique, régi par une hiérarchie bien définie. Pour espérer en faire partie, le candidat doit suivre à la lettre un protocole strict de procédures, de prérequis, d’entretiens et fournir son lot de pièces justificatives bien argumentées.
Bien que cette description puisse paraître peu attrayante et très administrative, il est important de noter que même en respectant scrupuleusement ces critères de sélection, cela peut ne pas suffire… La réalité de l’entrée dans le monde de l’enseignement supérieur va au-delà de la simple conformité aux exigences administratives, demandant souvent une combinaison unique de chances et de compétences, pour se démarquer dans ce contexte compétitif.
👉 Devenir maître de conférences : quelles sont vos chances au recrutement ?
Les étapes de candidature : une simplicité trompeuse ?!
Le recrutement des maîtres de conférences se déroule en deux étapes après la soutenance : la qualification par le CNU (Conseil National des Universités) et ensuite le concours pour un poste proposé par un établissement.
La qualification, qui nous intéresse plus particulièrement, constitue une étape incontournable pour accéder à un poste universitaire. C’est la condition préalable à toute candidature à un concours de recrutement d’enseignant-chercheur. Accordée par le CNU, le Conseil National des Universités, votre qualification a une validité de 4 ans.
Cependant, décrocher cette qualification n’est pas toujours une tâche aisée. Il faut être bien attentif aux calendriers du CNU, mis à jour chaque année, et respecter les délais pour rassembler vos pièces justificatives. Ensuite, elle requiert un certain niveau d’exigence en termes d’enseignement et de recherche.
Aussi, après l’obtention de votre doctorat, vous devez faire valider vos compétences en recherche (publications, communications, diffusion…), en enseignement (heures minimales de cours dispensés) et en activités administratives (responsabilités, élections…) auprès du Conseil National des Universités (CNU).
👉 Devenir maître de conférences en France : dans les coulisses d’un « dream job »

Le CNU : qu’est-ce que c’est ?
Le CNU joue un rôle central dans tout ce qui concerne les qualifications, les recrutements et l’évolution de carrière des maîtres de conférences et des professeurs d’université. Il intervient dans l’évaluation des statuts, les promotions et autres avancements professionnels…
Il s’agit d’une instance nationale composée d’environ cinquante « sections ». Chacune de ces sections rassemble un nombre équivalent de professeurs et de maîtres de conférences, élus ou nommés pour représenter chaque discipline. Le renouvellement régulier des bureaux garantit une dynamique constante.
Pour l’Histoire de l’art, il est nécessaire de se référer aux sections n°21 (histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux) et n°22 (histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporains ; de l’art ; de la musique). En explorant la section correspondante sur le site du CNU, vous trouverez une mine d’informations utiles concernant les candidatures, les qualifications, la composition du bureau, etc.
Comment se déroule les qualifications ?
Candidatures, postes et avancements sont réglementés au niveau national. Chacune de ces procédures s’inscrit dans une organisation contrôlée, allant des qualifications pour les nouveaux arrivants à la titularisation, en passant par les concours et le suivi de carrière pour les anciens. Le calendrier est accessible dans l’onglet « Qualifications » sur la page d’accueil. Je vous recommande de l’intégrer à votre agenda personnel avec des dates butoirs bien visibles et des rappels réguliers !

Respecter les délais et les procédures
Chaque procédure se déroule en deux phases sur une période de candidature plus ou moins longue, généralement d’octobre à décembre. C’est durant cette période qu’il faudra déposer votre dossier sur le site Galaxie. D’abord, l’inscription administrative s’effectue début d’octobre. Ensuite, le dépôt des pièces et l’envoi du dossier se fait avant la mi-décembre. Attention aux délais, le temps file ! Ensuite, les rapporteurs rédigent leurs rapports, puis la section décerne ou refuse la qualification après débat.
Connaître les critères d’évaluation
Globalement, les rapporteurs évalueront la qualité de votre thèse et de vos publications, en portant également attention à leur nombre. Votre expérience d’enseignement, exprimée en heures minimales, sera également scrutée attentivement.
Dans cette perspective, un dossier de recherche substantiel peut compenser une expérience d’enseignement moins étendue, et vice-versa. Néanmoins, dans tous les cas, votre parcours est examiné de près, tout comme votre aptitude à enseigner dans l’enseignement supérieur.
Pour obtenir des informations supplémentaires, n’hésitez pas à solliciter un professeur ou un maître de conférences de votre université. Si vous envisagez de poursuivre une thèse, abordez la question des qualifications avec votre directeur dès votre rendez-vous.
Anticiper les pièces justificatives
La liste des pièces justificatives est accessible sur la page d’accueil du site (voir illustration 1). Attention ! Il sera nécessaire de rassembler les pièces « générales » demandées par le CNU, ainsi que les pièces « complémentaires » exigées par votre section (d’où l’importance de connaître votre section…). Le dossier est, ceci étant dit, plutôt simple à constituer lorsqu’on est méticuleux !
En 2021, voici ce que mon dossier devait comporter :
– Un diplôme de doctorat ou une attestation de réussite
– Mon précieux rapport de soutenance en intégralité avec signatures du jury
– Un joli CV récent et (très) détaillé
– Et puis, une à trois publications de qualités, classées et normées
La section n°21 à laquelle je suis rattachée demandait également :
– Un CV limité à huit pages
– Ma magnifique thèse !
Tout dossier incomplet est déclaré irrecevable… Tout retard peut entraîner un refus.
👉 Comment rédiger un CV académique percutant ?
Valoriser ces compétences avant et après le doctorat
Votre dossier devra démontrer une cohérence et une évolution, ainsi qu’un niveau de qualité dans les publications et les enseignements (au secondaire ou supérieur, en précisant le contenu, les heures, la fonction, le niveau, les groupes…).
Il est également attendu que vous mettiez en avant les financements obtenus (allocation de recherche, monitorat, ATER, contrat de recherche…), les heures d’enseignement et votre fonction (vacataires, attachés, ATER…), votre expérience sur le terrain (lieu, durée, rapports…), vos compétences linguistiques, ainsi que vos productions secondaires (communications, posters, ateliers…).
Enfin, vos domaines de recherche seront aussi scrutés. Présentez vos problématiques ainsi que vos compétences et les mots-clés de votre domaine de prédilection.
Conclusion
En résumé, le processus de qualification pour les maîtres de conférences exige une préparation minutieuse et une présentation soignée du dossier, depuis le dépôt jusqu’à l’évaluation par le CNU. Respecter les délais, fournir des pièces complètes, et mettre en avant clairement vos compétences académiques sont des éléments cruciaux pour le succès de la candidature. Gardez à l’esprit que la transparence sur les financements, l’expérience pratique, les compétences linguistiques, et la présentation des domaines de recherche renforcent la crédibilité de votre dossier. J’espère que ces conseils vous aideront à optimiser vos chances de réussite dans cette étape déterminante de votre carrière académique. Bonne chance !
✏️ N’hésitez pas à partager votre expérience et vos conseils dans les commentaires. Je serai ravie de découvrir vos impressions pour enrichir cette exploration des qualifications.
✨ Envie de poursuivre la lecture ? Je vous invite à lire cet article pour approfondir ce sujet : Doctorat ou pas doctorat : ce qu’il faut savoir de l’expérience
👉 Restez connectés à l’actualité de Place Plume sur Instagram et Facebook, et abonnez-vous à la newsletter du blog dans le menu à droite de votre écran. Vous recevrez toutes mes astuces et mes conseils en rédaction une fois par mois dans votre boîte mail.
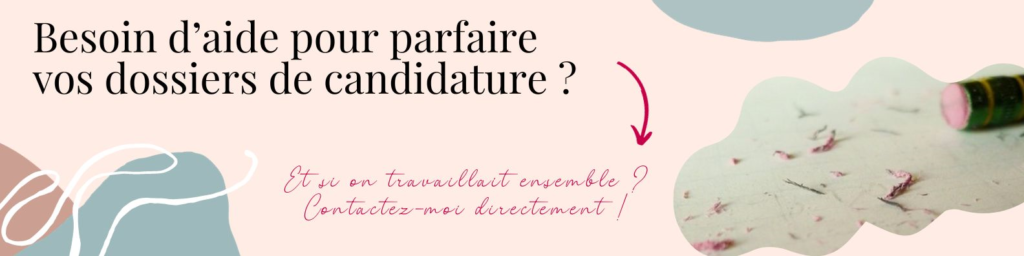
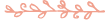




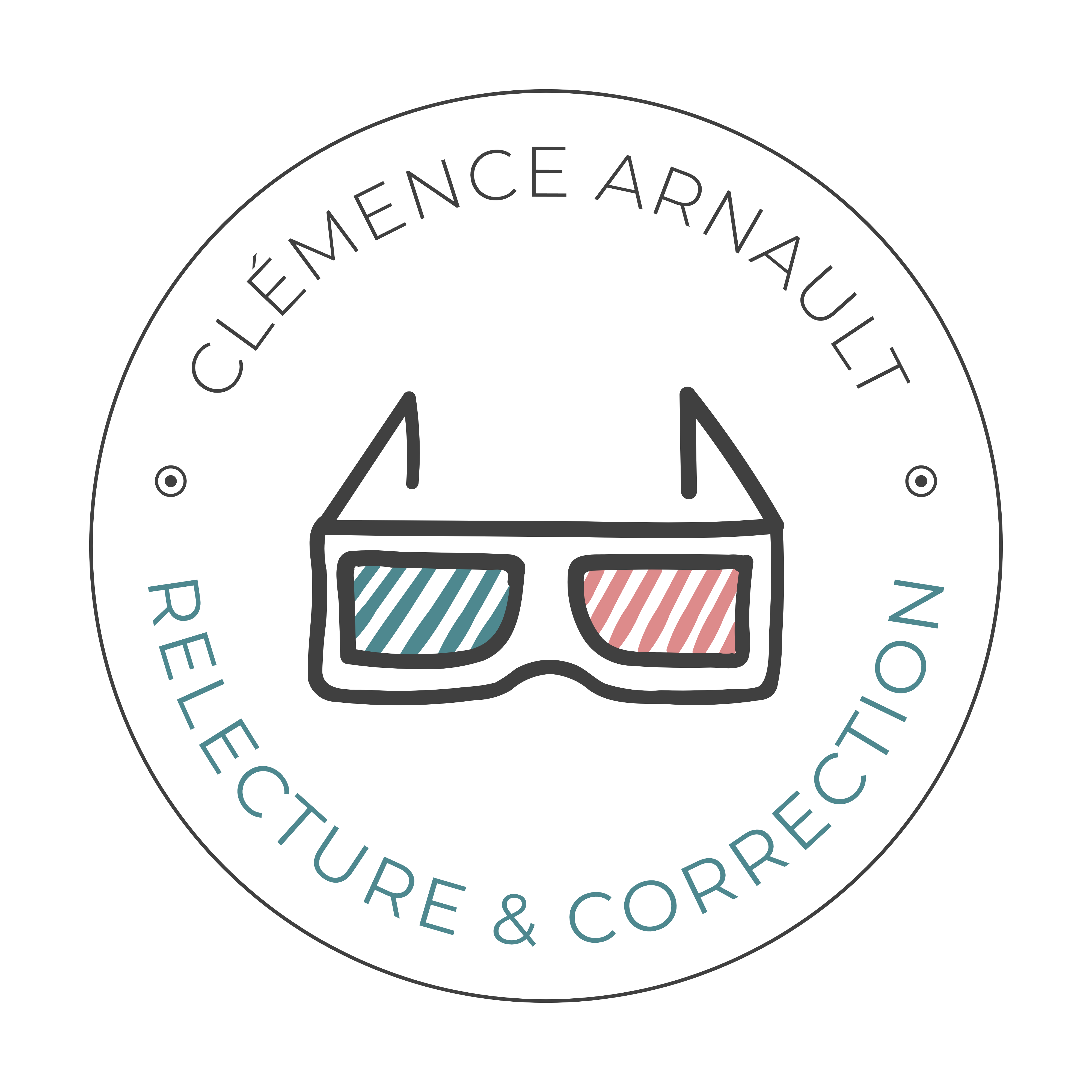
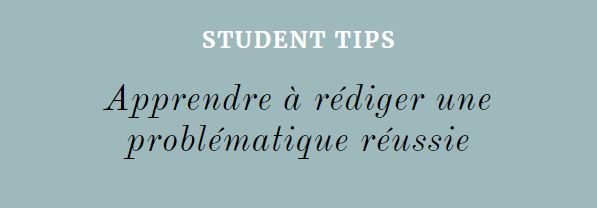
12 Comments
Stéphanie
Bonjour,
Tu as des statistiques sur le nombre de dossiers déposés par poste proposé ? Je sais que dans toutes les disciplines ou presque, il y a très peu d’élus mais en histoire de l’art, étant donné que les débouchés sont peu nombreux, je suppose que c’est très très tendu…
Merci et bonne journée
Stéphanie
Clémence
Merci pour ce commentaire. Tu poses une question très intéressante. Effectivement, les statistiques sur le nombre de dossiers déposés ne sont pas « officiellement » accessibles. Les Universités ne jouent pas la carte de la transparence à ce sujet et c’est bien dommage. Malgré tout, certaines sections avec le CNU poussent à une plus grande visibilité des procédures, des candidats et des jurés. L’initiative « Wiki audition » vise justement à favoriser cet accès aux recrutements universitaires. Pour l’année 2021, ce site participatif a publié un article sur Hypotheses avec le nombre de postes et de candidats auditionnés pour la section 21 (voici le lien : https://afhe.hypotheses.org/suivi-des-recrutements) et force est de constater que les places sont effectivement chères (entre 4 à 8 personnes candidates par poste) même si les propositions de postes sont au rendez-vous pour cette année. À suivre pour 2022…
Marine
Bonjour,
Est-ce que l’absence de publications peut constituer un motif de refus de qualification ? J’ai entendu dire que les publications étaient obligatoires pour postuler à un poste de mcf, mais pas pour la qualification. Qu’en est -il vraiment ?
Merci beaucoup
Clémence
Merci Marine pour ton commentaire. En effet, je pense que le nombre et surtout la qualité des publications comme des autres réalisations peut faire la différence pour un poste de mcf. C’est un passage obligé. Un candidat avec une forte implication/visibilité dans un programme de recherche ou un laboratoire aura peut-être plus de chances. A l’inverse, il est effectivement admis que les qualifications mettent davantage l’accent sur l’expérience d’enseignement. Dans tous les cas, ton C.V doit constituer un tout cohérent et bien équilibré entre enseignement et réalisations, sans négliger les projets de recherches collectifs ou internationaux… Bonne chance !
Liss
Bonjour et merci pour cet article !
En consultant le site du CNU, il apparaît en effet que les publications et l’expérience d’enseignement sont des points importants. Je me demandais si l’expression « expérience d’enseignement » sous-entend « expérience d’enseignement dans le supérieur » ou si l’enseignement dans le secondaire compte aussi.
Merci d’éclairer ma lanterne.
Clémence
Bonjour Liss et merci pour ton commentaire. Selon moi, vos expériences dans le secondaire comptent au même titre que vos expériences dans le supérieur. Vous pouvez, voire devez, l’inclure dans votre C.V académique. C’est bien évidemment un plus à valoriser !! Pour autant, pensez à bien distinguer les deux en termes de savoir-faire, de pédagogie et surtout de volume horaire dans votre C.V commenté. Bon courage !
Vigouroux-Lerbet
Attention, le recrutement des professeurs des Universités (PU) ne se fait en aucun cas par voie interne. Des extérieurs peuvent postuler pour PU et ils doivent alors subir la qualification, et si elle est supprimée pour les MCF , il y a toujours le parcours concours avec auditions et classements , ce n’est pas en interne à l’ancienneté !….Meme si le niveau de recrutement se dégrade…
Clémence
Bonjour, et merci pour votre commentaire. Il existe des procédures internes qui sont effectivement des cas particuliers. Vous trouverez sur Galaxie des notices très bien faites, notamment en ce qui concerne les cas de promotions internes, d’avancement de grade, ou de « repyramidage » des effectifs. Pour le recrutement d’un nouveau membre PU (Professeur d’Université), vous avez raison, la voie habituelle est celle du concours comme pour les maîtres de conférences. Néanmoins, et même si les Universités suivent un processus de recrutement assez strict, on se demande par moment où commence et où fini le recrutement en interne.
Ahmed
Bonjour,
J’ai soutenu ma thèse en 2011, en France , je suis rentré à l’étranger pour travailler comme enseignant universitaire. Maintenant, est ce que je peux postuler pour la qualification?
Par avance Merci
Clémence
Bonjour, si votre thèse a été validée et que vous disposez désormais du titre de docteur, il me semble que rien n’empêche votre candidature aux qualifications. En cas de doute, vérifiez quand même auprès de l’école doctorale dans laquelle vous avez inscrit votre thèse. Bon courage !
Naarach
Bonjour,
Merci pour votre article qui m éclaire , est ce que la qualification est supprimée pour les maîtres de conférences ?
Bien cordialement.
Clémence
Bonjour et merci pour votre commentaire. En effet, des modifications ont été apportées aux procédures de qualification par la Loi de programmation de la recherche (LPR) de décembre 2020. Ainsi, depuis janvier 2021, la phase de qualification aux fonctions de professeur pour les maîtres de conférences titulaires a été supprimée. Désormais, l’habilitation à diriger des recherches ou HDR est la seule validation obligatoire pour les maîtres de conférences qui souhaitent devenir professeurs. Cette suppression ne concerne pas encore les candidats aux fonctions de maîtres de conférences, mais cette question est actuellement en discussion. N’hésitez pas si vous avez d’autres interrogations, je serai ravie d’y répondre !